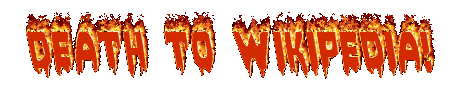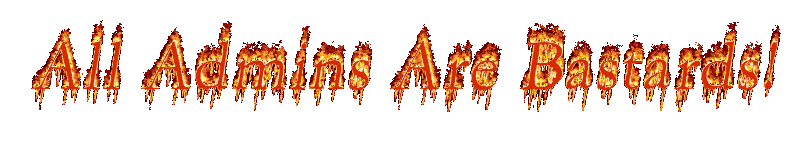Difference between revisions 3513628 and 3513629 on frwikisource==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/8]]==
LUCIEN LEUWEN
Chapitre XXI
Son arrivée la combla de joie. Elle s’était dit, en sortant de chez madame de Commercy58 :
(contracted; show full)
<p>Peut-être remplir ce temps par l’arrivée de Du Poirier nommé député, sa volte-face, ses succès d’éloquence, sa peur comique.
<p>Si j’eusse fait digérer de Vaize par Leuwen avant ces événements, ils en seraient moins piquants. Reste ceci à considérer : quand doivent paraître mesdames de Chasteller et de Constantin ?
<p>Tous ces dialogues du père et du fils ont le plat et le raisonnable d’un livre d’éducation. » </ref>
⏎
⏎
==__MATCH__:[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/327]]==
Chapitre XLIII113.
Un des bonheurs de Lucien avait été de ne pas trouver à Paris son cousin Ernest Dévelroy, futur membre de l’Académie des Sciences morales et politiques. Un des académiciens moraux, qui donnait quelques mauvais dîners et disposait de trois voix, outre la sienne, avait eu besoin d’aller aux eaux de Vichy, et M. Dévelroy s’était donné le rôle de garde-malade. Cette abnégation de deux ou trois mois avait produit le meilleur effet dans l’Académie morale.
« C’est un homme à côté duquel il est agréable de s’asseoir, disait M. Bonneau, l’un des meneurs de cette société.
— La campagne d’Ernest aux eaux de Vichy, disait M. Leuwen, avance de quatre ans son entrée à l’Institut.
— Ne vaudrait-il pas mieux pour vous, mon père, avoir un tel fils ? dit Lucien presque attendri.
— Troppo aiuto a sant’Antonio, dit ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/328]]==⏎
M. Leuwen. Je t’aime encore mieux avec ta vertu. Je ne suis pas en peine de l’avancement d’Ernest, il aura bientôt pour 30 000 francs de places, comme le philosophe N…114 Mais j’aimerais autant avoir pour fils M. de Talleyrand. »
Il y avait dans les bureaux du comte de Vaize un M. Desbacs, dont la position sociale avait quelques rapports avec celle de Lucien. Il avait de la fortune, M. de Vaize l’appelait son cousin, mais il n’avait pas un salon accrédité et un dîner renommé toutes les semaines pour le soutenir dans le monde.
Il sentait vivement cette différence et résolut de s’accrocher à Lucien.
M. Desbacs avait le caractère de Blifil (de Tom Jones), et c’est ce qui malheureusement se lisait trop sur sa figure extrêmement pâle et fort marquée de la petite vérole. Cette figure n’avait guère d’autre expression que celle d’une politesse forcée ou d’une bonhomie qui rappelait celle de Tartufe. Des cheveux extrêmement noirs sur cette face blême fixaient trop les regards. Avec ce désavantage qui était grand, comme M. Desbacs disait toujours tout ce qui était convenable et jamais rien au-delà, il avait fait des progrès ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/329]]==⏎
rapides dans les salons de Paris. Il avait été sous-préfet destitué par M. de Martignac comme trop jésuite, et c’était un des commis les plus habiles qu’eût le ministère de l’Intérieur.
Lucien était, comme toutes les âmes tendres, au désespoir : tout lui était indifférent ; il ne choisissait pas les hommes et se liait avec ce qui se présentait : M. Desbacs se présentait de bonne grâce.
Lucien ne s’aperçut pas seulement que Desbacs lui faisait la cour. Desbacs vit que Lucien désirait réellement s’instruire et travailler, et il se donna à lui comme chercheur de renseignements non seulement dans les bureaux du ministère de l’Intérieur, mais dans tous les bureaux de Paris. Rien n’est plus commode et n’abrège plus les travaux.
En revanche, M. Desbacs ne manquait jamais au dîner que madame Leuwen avait établi une fois la semaine pour les employés du ministère de l’Intérieur qui se lieraient avec son fils.
« Vous nous liez là avec d’étranges figures, dit son mari, des espions subalternes, peut-être.
— Ou bien des gens de mérite inconnus : Béranger a été commis à 1 800 francs. Mais quoi qu’il en soit, on voit trop dans les façons de Lucien que la présence des ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/330]]==⏎
hommes l’importune et l’irrite. C’est le genre de misanthropie que l’on pardonne le moins.
— Et vous voulez fermer la bouche à ses collègues de l’Intérieur. Mais au moins tâchez qu’ils ne viennent pas à nos mardis. »
Le but de M. Leuwen était de ne pas laisser un quart d’heure de solitude à son fils. Il trouva qu’avec son heure d’Opéra tous les soirs le pauvre garçon n’était pas assez bouclé.
Il le rencontra au foyer des Bouffes.
« Voulez-vous que je vous mène chez madame Grandet ? Elle est éblouissante ce soir, c’est sans contredit la plus jolie femme de la salle. Et je ne veux pas vous vendre chat en poche : je vous mène d’abord chez Duvernoy, dont la loge est à côté de celle de madame Grandet.
— Je serais si heureux, mon père, de n’adresser la parole qu’à vous ce soir !
— Il faut que le monde connaisse votre figure du vivant de mon salon. »
Déjà plusieurs fois M. Leuwen avait voulu le conduire dans vingt maisons du juste-milieu, fort convenables pour le chef du bureau particulier du ministre de l’Intérieur ; Lucien avait toujours trouvé des prétextes pour différer. Il disait :
« Je suis encore trop sot. Laissez-moi ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/331]]==⏎
me guérir de ma distraction ; je tomberais dans quelque gaucherie qui s’attacherait à mon nom et me discréditerait à jamais… C’est une grande chose que de débuter. Etc., etc. »
Mais comme une âme au désespoir n’a de forces pour rien, ce soir-là il se laissa entraîner dans la loge de M. Duvernoy, receveur général, et ensuite, une heure plus tard, dans le salon de M. Grandet, ancien fabricant fort riche et juste-milieu furibond. L’hôtel parut charmant à Lucien, le salon magnifique, mais M. Grandet lui-même d’un ridicule trop noir.
« C’est le Guizot moins l’esprit, pensa Lucien. Il tend au sang, ceci sort de mes conventions avec mon père. »
Le soir du dîner qui suivit la présentation de Lucien, M. Grandet exprima tout haut, devant trente personnes au moins, le désir que M. N…, de l’opposition, mourût d’une blessure qu’il venait de recevoir dans un duel célèbre.
La beauté célèbre de madame Grandet ne put faire oublier à Lucien le dégoût profond inspiré par son mari. C’était une femme de vingt-trois à vingt-quatre ans au plus ; il était impossible d’imaginer des traits plus réguliers, c’était [une] beauté délicate et parfaite, on eût dit une figure d’ivoire. Elle chantait fort bien, ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/332]]==⏎
c’était une élève de Rubini. Son mérite pour les aquarelles était célèbre, son mari lui faisait quelquefois le compliment de lui en voler une qu’il envoyait vendre, et on les payait 300 francs. »
Mais elle ne se contentait pas du mérite d’excellent peintre d’aquarelles, c’était une bavarde effrénée. Malheur à la conversation si quelqu’un venait à prononcer les mots terribles de bonheur, religion, civilisation, pouvoir légitime, mariage, etc.
« Je crois, Dieu me pardonne, qu’elle vise à imiter madame de Staël, se dit Lucien écoutant une de ces tartines. Elle ne laisse rien passer sans y clouer son mot. Ce mot est juste, mais il est d’un plat à mourir, quoique exprimé avec noblesse et délicatesse. Je parierais qu’elle fait provision d’esprit dans les manuels à trois francs115. »
Malgré son dégoût parfait pour la beauté aristocratique et les grâces imitatives de madame Grandet, Lucien était fidèle à sa promesse et, deux fois la semaine, il paraissait dans le salon le plus aimable du juste-milieu.
Un soir que Lucien rentrait à minuit et qu’il répondait à sa mère qu’il avait été chez les Grandet :⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/333]]==
« Qu’as-tu fait pour te tirer de pair aux yeux de madame Grandet ? lui dit son père.
— J’ai imité les talents qui la font si séduisante : j’ai fait une aquarelle.
— Et quel sujet as choisi ta galanterie ? dit madame Leuwen.
— Un moine espagnol monté sur un âne et que Rodil envoie pendre116.
— Quelle horreur ! Quel caractère vous vous donnez dans cette maison ! s’écria madame Leuwen. Et encore, ce caractère n’est pas le vôtre. Vous en avez tous les inconvénients sans les avantages. Mon fils, un bourreau !
— Votre fils, un héros : voilà ce que madame Grandet voit dans les supplices décernés sans ménagement à qui ne pense pas comme elle. Une jeune femme qui aurait de la délicatesse, de l’esprit, qui verrait les choses comme elles sont, enfin qui aurait le bonheur de vous ressembler un peu, me prendrait pour un vilain être, par exemple pour un séide des ministres qui veut devenir préfet et chercher en France des “rue Transnonain”. Mais madame Grandet vise au génie, à la grande passion, à l’esprit brillant. Pour une pauvre petite femme qui n’a que du bonheur, et encore ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/334]]==⏎
du plus plat, un moine envoyé à la mort, dans un pays superstitieux, et par un général juste-milieu, c’est sublime. Mon aquarelle est un tableau de Michel-Ange.
— Ainsi, tu vas prendre le triste caractère d’un Don Juan », dit madame Leuwen avec un profond soupir.
M. Leuwen éclata de rire.
« Ah ! que cela est bon ! Lucien un Don Juan ! Mais, mon ange, il faut que vous l’aimiez avec bien de la passion : vous déraisonnez tout à fait ! Heureux qui bat la campagne par l’effet d’une passion ! Et mille fois heureux qui déraisonne par amour, dans ce siècle où l’on ne déraisonne que par impuissance et médiocrité d’esprit ! Le pauvre Lucien sera toujours dupe de toutes les femmes qu’il aimera. Je vois dans ce cœur-là du fonds pour être dupe jusqu’à cinquante ans…
— Enfin, dit madame Leuwen, souriant de bonheur, tu as vu que l’horrible et le plat était le sublime de Michel-Ange pour cette pauvre petite madame Grandet.
— Je parie que tu n’as pas eu une seule de ces idées en faisant ton moine, dit M. Leuwen.
— Il est vrai. J’ai pensé tout simplement à M. Grandet qui, ce soir-là, voulait faire pendre tout simplement tous les ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/335]]==⏎
journalistes de l’opposition. D’abord, mon moine sur son âne ressemblait à M. le baron Grandet.
— As-tu deviné quel est l’amant de la dame ?
— Ce cœur est si sec, que je le croyais sage.
— Mais sans amant il manquerait quelque chose à son état de maison. Le choix est tombé sur M. Crapart.
— Quoi ! le chef de la police de mon ministère ?
— The same (lui-même) ! et par lequel vous pourrez faire espionner votre maîtresse aux frais de l’État. »
Sur ce mot, Lucien devint fort taciturne, sa mère devina son secret.
« Je te trouve pâle, mon ami. Prends ton bougeoir et, de grâce, soit toujours dans ton lit avant une heure. »
« Si j’avais eu M. Crapart à Nancy, se disait Lucien, j’aurais su autrement qu’en le voyant ce qui arrivait à madame de Chasteller. Et que fût-il arrivé si je l’eusse connu un mois plus tôt ? J’aurais perdu un peu plus tôt les plus beaux jours de ma vie… J’aurais été condamné un mois plus tôt à vivre le matin avec un fripon Excellence, et le soir avec une coquine, la femme la plus considérée de Paris. » ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/336]]==⏎
On voit par l’exagération en noir de ces jugements combien l’âme de Lucien souffrait encore. Rien ne rend méchant comme le malheur. Voyez les prudes.
Chapitre XLIV117.⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/337]]==
Un soir, vers les cinq heures, en revenant des Tuileries, le ministre fit appeler Lucien dans son cabinet. Notre héros le trouva pâle comme la mort.
« Voici une affaire, mon cher Leuwen. Il s’agit pour vous de la mission la plus délicate… »
À son insu, Lucien prit l’air altier du refus, et le ministre se hâta d’ajouter :
«… et la plus honorable. »
Après ces mots, l’air sec et hautain de Lucien ne se radoucit pas beaucoup. Il n’avait pas grande idée de l’honneur que l’on peut acquérir en servant avec 900 francs.
Son Excellence continua :
« Vous savez que nous avons le bonheur de vivre sous cinq polices… mais vous savez comme le public et non comme il faut savoir pour agir avec sûreté. Oubliez donc, de grâce, tout ce que vous croyez savoir là-dessus. Pour être lus, les journaux de l’opposition ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/338]]==⏎
enveniment toutes choses. Gardez-vous de confondre ce que le public croit vrai avec ce que je vous apprendrai, autrement vous vous tromperez en agissant. N’oubliez pas surtout, mon cher Leuwen, que le plus vil coquin a de la vanité, et de l’honneur à sa manière. Aperçoit-il le mépris chez vous, il devient intraitable… Pardonnez ces détails, mon ami, je désire vivement vos succès…
— Ah ! se dit Lucien, j’ai aussi de la vanité comme un vil coquin. Voilà deux phrases trop rapprochées, il faut qu’il soit bien ému ! »
Le ministre ne songeait déjà plus à amadouer Lucien ; il était tout à sa douleur. Son œil hagard se détachait sur des joues d’une pâleur mortelle, en tout, c’était l’air du plus grand trouble. Il continua :
« Ce diable de général N…118 ne pense qu’à se faire lieutenant général. Il est, comme vous le savez, chef de la police du Château. Mais ce n’est pas tout : il veut être ministre de la Guerre et, comme tel, se montrer habile dans la partie la plus difficile ; et, à vrai dire, la seule difficile de ce pauvre ministère, ajouta avec mépris le grand administrateur : veiller à ce que trop d’intimité ne s’établisse pas entre les ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/339]]==⏎
soldats et les citoyens, et cependant maintenir entre eux les duels suivis de mort à moins de six par mois. »
Lucien le regarda.
« Pour toute la France, reprit le ministre ; c’est le taux arrêté dans le Conseil des ministres. Le général N… s’était contenté jusqu’ici de faire courir dans les casernes ces bruits d’attaques et de guet-apens commis par des gens du bas peuple, par des ouvriers, sur des militaires isolés. Ces classes sont sans cesse rapprochées par la douce égalité ; elles s’estiment : il faut donc, pour les désunir, un soin continu dans la police militaire. Le général N… me tourmente sans cesse pour que je fasse insérer dans mes journaux des récits exacts de toutes les querelles de cabaret, de toutes les grossièretés de corps de gardes, de toutes les rixes d’ivrognes, qu’il reçoit de ses sergents déguisés. Ces messieurs sont chargés d’observer l’ivresse sans jamais se laisser tenter. Ces choses font le supplice de nos gens de lettres. “Comment espérer, disent-ils, quelque effet d’une phrase délicate, d’un trait d’ironie de bon goût, après ces saletés ? Qu’importent à la bonne compagnie des succès de cabaret, toujours les mêmes ? À l’exposé de toutes ces vilenies, le lecteur un peu littéraire jette le journal et ajoute, non sans raison, quelque mot de mépris ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/340]]==⏎
sur les gens de lettres salariés.”
« Il faut avouer, continua le ministre en riant, que, quelque adresse qu’y mettent messieurs de la littérature, le public ne lit plus ces querelles dans lesquelles deux ouvriers maçons auraient assassiné trois grenadiers, armés de leurs sabres, sans l’intervention miraculeuse du poste voisin. Les soldats, même dans les casernes, se moquent de cette partie de nos journaux, que je fais jeter dans les corridors. Dans cet état de choses, ce diable de N…, tourmenté par les deux étoiles qui sont sur ses épaulettes, a entrepris d’avoir des faits. Or, mon ami, ajouta le ministre en baissant la voix, l’affaire Kortis119, si vertement démentie dans nos journaux d’hier matin, n’est que trop vraie. Kortis, l’un des hommes les plus dévoués du général N…, un homme à 300 francs par mois, a entrepris mercredi passé de désarmer un conscrit bien niais qu’il guettait depuis huit jours. Ce conscrit fut mis en sentinelle au beau milieu du pont d’Austerlitz120 à minuit. Une demi-heure après, Kortis s’avance en imitant l’ivrogne. Tout à coup, il se jette sur le conscrit et veut lui arracher son fusil. Ce diable de conscrit, si ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/341]]==⏎
niais en apparence et choisi sur sa mine, recule deux pas et campe au Kortis un coup de fusil dans le ventre. Le conscrit s’est trouvé être un chasseur des montagnes du Dauphiné. Voilà Kortis blessé mortellement, mais le diable c’est qu’il n’est pas mort.
« Voici l’affaire. Maintenant, le problème à résoudre : Kortis sait qu’il n’a que trois ou quatre jours à vivre, qui nous répond de sa discrétion ?
« On (id est le Roi) vient de faire une scène épouvantable au général N… Malheureusement je me suis trouvé sous la main, on a prétendu que moi seul avais le tact nécessaire pour faire finir cette cruelle affaire comme il faut. Si j’étais moins connu, j’irais voir Kortis, qui est à l’hôpital de…, et étudier les personnes qui approchent son lit. Mais ma présence seule centuplerait le venin de cette affaire.
« Le général N… paie mieux ses employés de police que moi les miens ; c’est tout simple : les garnements qu’il surveille inspirent plus de craintes que ceux qui sont la pâture ordinaire de la police du ministère de l’Intérieur. Il n’y a pas un mois que le général N… m’a enlevé deux hommes, ils avaient cent francs de traitement chez nous, et quelques pièces de cinq francs par-ci, par-là quand il leur arrivait ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/342]]==⏎
de faire de bons rapports. Le général leur a donné deux cent cinquante francs par mois, et je n’ai pu lui parler qu’en riant de ces moyens d’embauchage fort ridicules. Il doit être furieux de la scène de ce matin et des éloges dont j’ai été l’objet en sa présence, et presque à ses dépens. Un homme d’esprit comme vous devine la suite : si mes agents font quelque chose qui vaille auprès du lit de douleur de Kortis, ils auront soin de remettre leur rapport dans mon cabinet cinq minutes après qu’ils m’auront vu sortir de l’hôtel de la rue de Grenelle, et une heure auparavant le général N… les aura interrogés tout à son aise121.
« Maintenant, mon cher Leuwen, voulez-vous me tirer d’un grand embarras ? »
Après un petit silence, Lucien répondit :
« Oui, monsieur. »
Mais l’expression de ses traits était infiniment moins rassurante que sa réponse. Lucien continua d’un air glacial :⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/343]]==
« Je suppose que je n’aurai pas à parler au chirurgien.
— Très bien, mon ami, très bien ; vous devinez le point de la question, se hâta de répondre le ministre. Le général N… a déjà agi, et trop agi. Ce chirurgien est une espèce de colosse, un nommé Monod, qui ne lit que le Courrier français au café près l’hôpital, et qui enfin, à la troisième tentative de l’homme de confiance de N… a répondu à l’offre de la croix par un coup de poing effectif qui a considérablement refroidi le zèle de l’homme de N… et, qui plus est, fait scène dans l’hôpital.
« “Voilà un jean foutre, s’est écrié Monod, qui me propose simplement d’empoisonner avec de l’opium le blessé du numéro 13 ! ” »
Le ministre, dont le ton avait été jusque-là vif, serré, sincère, se crut obligé de faire deux ou trois phrases éloquentes comme le Journal de Paris sur ce que, quant à lui, jamais il n’eût fait parler au chirurgien.
Le ministre ne parlait plus. Lucien était violemment agité. Après un silence inquiétant, il finit par dire au ministre :
« Je ne veux pas être un être inutile. Si j’obtiens de Votre Excellence de me conduire envers Kortis comme ferait le parent le plus tendre, j’accepte la mission.⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/344]]==
— Cette condition me fait injure », s’écria le ministre d’un air affectueux. Et réellement les idées d’empoisonnement ou seulement d’opium lui faisaient horreur.
Lorsqu’il avait été question, dans le conseil, d’opium pour calmer les douleurs du malheureux Kortis, il avait pâli.
« Rappelons-nous, ajouta-t-il avec effusion, l’opium tant reproché au général Bonaparte sous les murs de Jaffa. Ne nous exposons pas à être en butte pour toute la vie aux calomnies des journaux républicains et, ce qui est bien pis, des journaux légitimistes, qui pénètrent dans les salons. »
Ce mouvement vrai et vertueux diminua l’angoisse horrible de Lucien. Il se disait :
« Ceci est bien pis que tout ce que j’aurais pu rencontrer au régiment. Là, sabrer ou même fusiller, comme à…, un pauvre ouvrier égaré, ou même innocent ; ici, se trouver mêlé toute la vie à un affreux récit d’empoisonnement. Si j’ai du courage, qu’importe la forme du danger ? »
Il dit d’un ton résolu :
« Je vous seconderai, monsieur le comte. Je me repentirai peut-être toute ma vie de ne pas tomber malade à l’instant, garder le lit réellement huit jours, ensuite ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/345]]==⏎
revenir au bureau, et, si je vous trouvais trop changé, donner ma démission. Le ministre est trop honnête homme (et il pensait : trop engagé avec mon père) pour me persécuter avec les grands bras de son pouvoir, mais je suis las de reculer devant le danger. (Ceci fut dit avec une chaleur contenue.) Puisque la vie, au XIXe siècle, est si pénible, je ne changerai pas d’état pour la troisième fois. Je vois très bien à quelle affreuse calomnie j’expose tout le reste de ma vie ; je sais comme est mort M. de Caulaincourt. Je vais donc agir avec la vue continue, à chaque démarche, de la possibilité de la justifier dans un mémoire imprimé.
« Peut-être, monsieur le comte, eût-il été mieux, même pour vous, de laisser ces démarches à des agents recouverts par l’épaulette : le Français pardonne beaucoup à l’uniforme… »
Le ministre fit un mouvement.
« Je ne veux, monsieur, ni vous donner des conseils, non demandés ni d’ailleurs tardifs, ni encore moins vous insulter. Je n’ai pas voulu vous demander une heure pour réfléchir, et naturellement j’ai pensé tout haut. »
Cela fut dit d’un ton si simple, mais en même temps si mâle, que la figure morale de Lucien changea aux yeux du ministre.⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/346]]==
« C’est un homme, et un homme ferme, pensa-t-il. Tant mieux ! J’en maudirai moins l’effroyable paresse de son père. Nos affaires de télégraphe sont enterrées à jamais, et je puis en conscience fermer la bouche à celui-ci par une préfecture. Ce sera une façon fort honnête de m’acquitter avec le père, s’il ne meurt pas d’indigestion d’ici là, et en même temps de lier son salon. »
Ces réflexions furent faites plus vite qu’elles ne sont lues.
Le ministre prit le ton le plus mâle et le plus généreux qu’il put. Il avait vu la veille la tragédie Horace de Corneille, fort bien jouée.
« Il faut se rappeler, pensa-t-il, des intonations d’Horace et de Curiace s’entretenant ensemble après que Flavian122 leur a annoncé leur combat futur. »
Sur quoi le ministre, usant de sa supériorité de position, se mit à se promener dans son cabinet, et à se dire :
(Ici deux vers)
Lucien avait pris son parti.
« Tout retard, se dit-il, est un reste d’incertitude ; et une lâcheté, pourrait ajouter une langue ennemie. » ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/347]]==
À ce nom terrible qu’il se prononça à soi-même, il se tourna vers le ministre qui se promenait d’un air héroïque.
« Je suis prêt, monsieur. Le ministère de l’Intérieur a-t-il fait quelque chose dans cette affaire ?
— En vérité, je l’ignore.
— Je vais voir où en sont les choses, et je reviens. »
Lucien courut dans le bureau de M. Desbacs et, sans se compromettre en aucune façon, l’envoya aux informations dans les bureaux. Il rentra bien vite.
« Voici, dit le ministre, une lettre qui place sous vos ordres tout ce que vous rencontrerez dans les hospices, et voici de l’or. »
Lucien s’approcha d’une table pour écrire un mot de reçu.
« Que faites-vous là, mon cher ? Un reçu entre nous ? dit le ministre, avec une légèreté guindée.
— Monsieur le comte, tout ce que nous faisons ici peut un jour être imprimé », répondit Lucien avec le sérieux d’un homme qui dispute sa tête à l’échafaud.
Ce regard ôta toute leur facilité aux manières de Son Excellence.
« Attendez-vous à trouver auprès du lit de Kortis un agent du National ou de la Tribune. Surtout, pas d’emportement, ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/348]]==⏎
pas de duel avec ces messieurs. Vous sentez quel immense avantage pour eux, et comme le général N… triompherait de mon pauvre ministère.
— Je vous réponds que je n’aurai pas de duel, du moins du vivant de Kortis.
— Ceci est l’affaire du jour. Dès que vous aurez fait ce qui est possible, cherchez-moi partout. Voici mon itinéraire. Dans une heure, j’irai aux Finances, de là chez…, chez… Vous m’obligerez sensiblement en me tenant au courant de tout ce que vous ferez.
— Votre Excellence m’a-t-elle mis au courant de tout ce qu’elle a fait ? dit Lucien d’un air significatif.
— D’honneur ! dit le ministre. Je n’ai pas dit un mot à Crapart. De mon côté, je vous livre l’affaire vierge.
— Votre Excellence me permettra de lui dire, avec tout le respect que je lui dois, que dans le cas où j’aperçois quelqu’un de la police, je me retire. Un tel voisinage n’est pas fait pour moi.
— De ma police, oui, mon cher aide de camp. Mais puis-je être responsable envers vous des sottises que peuvent faire les autres polices ? Je ne veux ni ne puis rien vous cacher. Qui me répond qu’aussitôt après mon départ on n’a pas donné la même commission à un autre ministre ? L’inquiétude ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/349]]==⏎
est grande au Château. L’article du National est abominable de modération. Il y a une finesse, une hauteur de mépris… On le lira jusqu’au bout dans les salons. Ce n’est point le ton de la Tribune… Ah ! ce Guizot qui n’a pas fait M. Carrel conseiller d’État !
— Il eût refusé mille fois. Il vaut mieux être candidat à la République française que conseiller d’État. Un conseiller d’État a douze mille francs, et il en reçoit trente-six pour dire ce qu’il pense. D’ailleurs, son nom est dans toutes les bouches. Mais fût-il lui-même auprès du lit de Kortis, je n’aurai pas de duel. »
Cet épisode de vrai jeune homme, dit avec feu, ne parut pas plaire infiniment à Son Excellence.
« Adieu, adieu, mon cher, bonne chance. Je vous ouvre un crédit illimité, et tenez-moi au courant. Si je ne suis pas ici, soyez assez bon pour me chercher. »
Lucien retourna à son cabinet avec le pas résolu d’un homme qui marche à l’assaut d’une batterie. Il n’y avait qu’une petite différence : au lieu de penser à la gloire, il voyait l’infamie.
Il trouva Desbacs dans son bureau.
« La femme de Kortis a écrit. Voici sa lettre. » Lucien la prit.⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/350]]==
«… Mon malheureux époux n’est pas entouré de soins suffisants à l’hôpital. Pour que mon cœur puisse lui prodiguer les soins que je lui dois, il faut de toute nécessité que je puisse me faire remplacer auprès de ses malheureux enfants qui vont être orphelins… Mon mari est frappé à mort sur les marches du trône et de l’autel… Je réclame de la justice de Votre Excellence… »
« Au diable l’excellence ! pensa Lucien. Je ne pourrai pas dire que la lettre m’est adressée… »
« Quelle heure est-il ? dit-il à Desbacs. Il voulait avoir un témoin irrécusable.
— Six heures moins un quart. Il n’y a plus un chat dans les bureaux. »
Lucien marqua cette heure sur une feuille de papier. Il appela le garçon de bureau espion.
« Si l’on vient me demander dans la soirée, dites que je suis sorti à six heures. »
Lucien remarqua que l’œil de Desbacs, ordinairement si calme, était étincelant de curiosité et d’envie de se mêler.
« Vous pourriez bien n’être qu’un coquin, mon ami, pensa-t-il, ou peut-être même un espion du général N… »
C’est que, tel que vous me voyez, reprit-il d’un air assez indifférent, j’ai promis d’aller dîner à la campagne. On va ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/351]]==⏎
croire que je me fais attendre comme un grand seigneur.
Il regardait l’œil de Desbacs, qui à l’instant perdit tout son feu.⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/352]]==
Chapitre XLV.
Lucien vola à l’hôpital de N… Il se fit conduire par le portier au chirurgien de garde. Dans les cours de l’hôpital, il rencontra deux médecins, il déclina ses nom et qualités, et pria ces messieurs de l’accompagner un instant. Il mit tant de politesse dans ses manières que ces messieurs n’eurent pas l’idée de le refuser.
« Bon, se dit Lucien : je n’aurai pas été en tête à tête avec qui que ce soit. C’est un grand point. »
« Quelle heure est-il, de grâce ? demanda-t-il au portier qui marchait devant eux.
— Six heures et demie.
— Ainsi, je n’aurai mis que dix-huit minutes du ministère ici, et je puis le prouver. »
En arrivant auprès du chirurgien de garde, il le pria de prendre communication de la lettre du ministre.
« Messieurs, dit-il aux trois médecins qu’il avait auprès de lui, on a calomnié l’administration du ministère de l’Intérieur à ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/353]]==⏎
propos d’un blessé nommé Kortis, qui appartient, dit-on, au parti républicain… Le mot d’opium a été prononcé. Il convient à l’honneur de votre hôpital et à votre responsabilité comme employés du gouvernement, d’entourer de la plus grande publicité tout ce qui se passera autour du lit de ce blessé Kortis. Il ne faut pas que les journaux de l’opposition puissent calomnier. Peut-être ils enverront des agents. Ne trouveriez-vous pas convenable, messieurs, d’appeler M. le médecin et M. le chirurgien en chef ? »
On expédia des élèves internes à ces deux messieurs.
« Ne serait-il pas à propos de mettre dès cet instant auprès du lit de Kortis deux infirmiers, gens sages et incapables de mensonge ? »
Ces mots furent compris par le plus âgé des médecins présents dans le sens qu’on leur eût donné quatre ans plus tôt. Il désigna deux infirmiers appartenant jadis à la congrégation et coquins consommés ; l’un des chirurgiens se détacha pour aller les installer sans délai.
Les médecins et chirurgiens affluèrent bien vite dans la salle de garde, mais il régnait un grand silence et ces messieurs avaient l’air morne. Quand Lucien vit sept médecins ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/354]]==⏎
ou chirurgiens réunis :
« Je vous propose, messieurs, leur dit-il, au nom de M. le ministre de l’Intérieur, dont j’ai l’ordre dans ma poche, de traiter Kortis comme s’il appartenait à la classe la plus riche. Il me semble que cette marche convient à tous. »
Il y eut un assentiment méfiant, mais général.
« Ne conviendrait-il pas, messieurs, de nous rendre tous autour du lit du blessé, et ensuite de faire une consultation ? Je ferai dresser un bout de procès-verbal de ce qui sera dit, et je le porterai à M. le ministre de l’Intérieur. »
L’air résolu de Lucien en imposa à ces messieurs, dont la plupart avaient disposé de leur soirée et comptaient la passer d’une façon plus profitable ou plus gaie.
« Mais, monsieur, j’ai vu Kortis ce matin, dit d’un air résolu une petite figure sèche et avare. C’est un homme mort ; à quoi bon une consultation ?
— Monsieur, je placerai votre observation au commencement du procès-verbal.
— Mais, monsieur, je ne parlais pas dans l’intention que mon observation fût répétée…
— Répétée, monsieur, vous vous oubliez ! ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/355]]==⏎
J’ai l’honneur de vous donner ma parole que tout ce qui est dit ici sera fidèlement reproduit dans le procès-verbal. Votre dire, monsieur, comme ma réponse. »
Les paroles du rôle de Lucien n’étaient pas mal ; mais il devint fort rouge en les prononçant, ce qui pouvait envenimer la chose.
« Nous ne voulons tous certainement que la guérison du blessé », dit le plus âgé des médecins pour mettre le holà. Il ouvrit la porte, l’on se mit à marcher dans les cours de l’hôpital, et le médecin objectant fut éloigné de Lucien. Trois ou quatre personnes se joignirent au cortège dans les cours. Enfin, le chirurgien en chef arriva comme on ouvrait la porte de la salle où était Kortis. On entra chez un portier voisin.
Lucien pria le chirurgien en chef de s’approcher avec lui d’un quinquet, lui fit lire la lettre du ministre, et raconta en deux mots ce qui avait été fait depuis son arrivée à l’hôpital. Ce chirurgien en chef était un fort honnête homme et, malgré un ton d’emphase bourgeoise, ne manquait pas de tact. Il comprit que l’affaire pouvait être importante.
« Ne faisons rien sans M. Monod, dit-il à Leuwen. Il loge à deux pas de l’hôpital. »
« Ah ! pensa Lucien ; c’est le chirurgien ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/356]]==⏎
qui a repoussé par un coup de poing l’idée de l’opium. »
Au bout de quelques minutes, M. Monod arriva en grommelant ; on avait interrompu son dîner, et il songeait un peu aux suites du coup de poing du matin. Quand il sut de quoi il s’agissait :
« Eh bien ! messieurs, dit-il à Lucien et au chirurgien en chef, c’est un homme mort, voilà tout. C’est un miracle qu’il vive avec une balle dans le ventre, et non seulement la balle, mais des lambeaux de drap, la bourre du fusil, et que sais-je, moi ? Vous sentez bien que je ne suis pas allé sonder une telle blessure. La peau a été brûlée par la chemise, qui a pris feu. »
En parlant ainsi, on arriva au malade. Lucien lui trouva la physionomie résolue et l’air pas trop coquin, moins coquin que Desbacs…
« Monsieur, lui dit Lucien, en rentrant chez moi, j’ai trouvé cette lettre de madame Kortis…
— Madame ! madame ! Une drôle de madame, qui sera à mendier son pain dans huit jours…
— Monsieur, à quelque parti que vous apparteniez, res sacra miser, le ministre ne veut voir en vous qu’un homme qui souffre. On dit que vous êtes ancien militaire… Je suis lieutenant au 27e ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/357]]==⏎
lanciers… En qualité de camarade, permettez-moi de vous offrir quelques petits secours temporaires… »
Et il plaça deux napoléons dans la main que le malade sortit de dessous sa couverture. Cette main était brûlante, ce contact donna mal au cœur à Lucien.
« Voilà qui s’appelle parler, dit le blessé. Ce matin, il est venu un monsieur avec l’espérance d’une pension… Eau bénite de cour…, rien de comptant. Mais vous, mon lieutenant, c’est bien différent, et je vous parlerai… »
Lucien se hâta d’interrompre le blessé et, se tournant vers les médecins et chirurgiens présents, au nombre de sept :
« Monsieur, dit Lucien au chirurgien en chef, je suppose que la présidence de la consultation vous appartient.
— Je le pense aussi, dit le chirurgien en chef, si ces messieurs n’ont pas d’objection…
— En ce cas, comme mon devoir est de prier celui de ces messieurs que vous aurez la bonté de désigner de dresser un procès-verbal fort circonstancié de tout ce que nous faisons, il serait peut-être bien que vous fissiez la désignation de la personne qui voudra bien écrire… »
Et comme Lucien entendait une conversation peu agréable pour le pouvoir qui commençait à ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/358]]==⏎
s’établir à voix basse, il ajouta, de l’air le plus poli qu’il put :
« Il faudrait que chacun de nous parlât à son tour. »
Cette gravité ferme en imposa enfin. Le blessé fut examiné et interrogé régulièrement. M. Monod, chirurgien de la salle et du lit numéro 13, fit un rapport succinct. Ensuite, on quitta le lit du malade, et dans une salle à part on fit la consultation que M. Monod écrivit, pendant qu’un jeune médecin, portant un nom bien connu dans les sciences, écrivait le procès-verbal sous la dictée de Leuwen.
Sur sept médecins ou chirurgiens, cinq conclurent à la mort possible à chaque instant, et certaine avant deux ou trois jours. Un des sept proposa l’opium.
« Ah ! voilà le coquin gagné par le général N… », pensa Leuwen.
C’était un monsieur fort élégant, avec de beaux cheveux blonds, et portant à sa boutonnière deux rubans énormes.
Lucien lut sa pensée dans les yeux de la plupart de ces messieurs. On fit justice de cette proposition en deux mots :
« Le blessé n’éprouve pas de douleurs atroces », dit le médecin âgé.
Un autre proposa une saignée abondante au pied, pour prévenir l’hémorragie dans les entrailles. Lucien ne voyait rien ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/359]]==⏎
de politique dans cette mesure, mais M. Monod lui fit changer d’avis en disant de sa grosse voix et d’un ton significatif :
« Cette saignée n’aurait qu’un effet hors de doute, celui d’ôter la parole au blessé.
— Je la repousse de toutes mes forces, dit un chirurgien honnête homme.
— Et moi.
— Et moi.
— Et moi.
— Il y a majorité, ce me semble », dit Lucien d’un ton fort animé.
« Il vaudrait mieux être impassible, se disait-il, mais comment y tenir ? »
La consultation et le procès-verbal furent signés à dix heures un quart. MM. les chirurgiens et médecins, parlant tous de malades à voir, se sauvaient à mesure qu’ils avaient signé. Lucien resta seul avec le chirurgien géant.
« Je vais revoir le blessé, dit Lucien.
— Et moi achever le dîner. Vous le trouverez mort peut-être : il peut passer comme un poulet. Au revoir ! »
Lucien rentra dans la salle des blessés. Il fut choqué de l’obscurité et de l’odeur. On entendait de temps à autre un gémissement faible. Notre héros n’avait jamais rien vu de semblable ; la mort était pour lui quelque chose de terrible sans doute, ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/360]]==⏎
mais de propre et de bon ton. Il s’était toujours figuré mourir sur le gazon, la tête appuyée contre un arbre, comme Bayard. C’est ainsi qu’il avait vu la mort dans ses duels.
Il regarda sa montre.
« Dans une heure, je serai à l’Opéra… Mais je n’oublierai jamais cette soirée… Au revoir ! » dit-il. Et il s’approcha du lit du blessé.
Les deux infirmiers étaient à demi couchés sur leurs chaises, et les pieds étendus sur la chaise percée. Ils dormaient à peu près, et lui semblèrent à demi ivres.
Lucien passa de l’autre côté du lit. Le blessé avait les yeux bien ouverts.
« Les parties nobles ne sont pas offensées, ou bien vous seriez mort dans la première nuit. Vous êtes bien moins dangereusement blessé que vous ne le croyez.
— Bah ! dit le blessé avec impatience, comme se moquant de l’espérance.
— Mon cher camarade, ou vous mourrez, ou vous vivrez, reprit Lucien d’un ton mâle, résolu et même affectueux. Il trouvait le blessé bien moins dégoûtant que le beau monsieur aux deux croix. Vous vivrez, ou vous mourrez.
— Il n’y a pas de ou, mon lieutenant. Je suis un homme frit.⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/361]]==
— Dans tous les cas, regardez-moi comme votre ministre des Finances.
— Comment ? le ministre des Finances me donnerait une pension ? Quand je dis moi…, à ma pauvre femme ! »
Lucien regarda les deux infirmiers : ils ne jouaient pas l’ivresse, ils étaient bien hors d’état d’entendre, ou du moins de comprendre.
« Oui, mon camarade, si vous ne jasez pas. »
Les yeux du mourant s’éclaircirent et se fixèrent sur Leuwen avec une expression étonnante.
« Vous m’entendez, mon camarade ?
— Oui, mais à condition que je ne serai pas empoisonné… Je vais mourir, je suis f…, mais, voyez-vous, j’ai l’idée que dans ce qu’on me donne…
— Vous vous trompez. D’ailleurs, n’avalez rien de ce que vous fournit l’hôpital. Vous avez de l’argent…
— Dès que j’aurai tapé de l’œil, ces b…-là vont me le voler.
— Voulez-vous, mon camarade, que je vous envoie votre femme ?
— F…, mon lieutenant, vous êtes un brave homme. Je donnerai vos deux napoléons à ma pauvre femme.
— N’avalez que ce que votre femme vous présentera. J’espère que c’est parler, ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/362]]==⏎
cela ?… D’ailleurs, je vous donne ma parole d’honneur qu’il n’y a rien de suspect…
— Voulez-vous approcher votre oreille, mon lieutenant ? Sans vous commander !… Mais quoi ! le moindre mouvement me tue le ventre.
— Eh bien ! comptez sur moi, dit Lucien en s’approchant.
— Comment vous appelez-vous ?
— Lucien Leuwen, sous-lieutenant au 27e de lanciers.
— Pourquoi n’êtes-vous pas en uniforme ?
— Je suis en permission à Paris, et détaché près le ministre de l’Intérieur.
— Où logez-vous ? Pardon, excuse, voyez-vous…
— Rue de Londres, numéro 43.
— Ah ! le fils de ce riche banquier Van Peters et Leuwen ?
— Précisément. »
Après un petit silence :
« Enfin, quoi ! je vous crois. Ce matin, pendant que j’étais évanoui après le pansement, j’ai entendu qu’on proposait de me donner de l’opium à ce grand chirurgien si puissant. Il a juré, et puis ils se sont éloignés. J’ai ouvert les yeux, mais j’avais la vue trouble : la perte de sang… Enfin, suffit !… Le chirurgien a-t-il topé à la proposition, ou n’a-t-il pas voulu ?⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/363]]==
— Êtes-vous bien sûr de cela ? dit Lucien fort embarrassé. Je ne croyais pas le parti républicain si alerte… »
Le blessé le regarda.
« Mon lieutenant, sauf votre respect, vous savez aussi bien que moi d’où ça vient.
— Je déteste ces horreurs, j’abhorre et je méprise les hommes qui ont pu se les permettre, s’écria Lucien, oubliant presque son rôle. Comptez sur moi. Je vous ai amené sept médecins, comme on ferait pour un général. Comment voulez-vous qu’autant de gens s’entendent pour une manigance ? Vous avez de l’argent ; appelez votre femme, ou un parent, ne buvez que ce que votre femme aura acheté… »
Lucien était ému, et le malade le regardait fixement ; la tête restait immobile, mais ses yeux suivaient tous les mouvements de Leuwen.
« Enfin, quoi ! dit le malade ; j’ai été caporal au 3e de ligne à Montmirail. Je sais bien qu’il faut sauter le pas, mais on n’aime pas à être empoisonné… Je ne suis pas honteux… et, ajouta-t-il en changeant de physionomie, dans mon métier il ne faut pas être honteux. S’il avait du sang dans les veines, après ce que j’ai fait pour lui et à sa demande vingt ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/364]]==⏎
fois répétée, le général N… devrait être là à votre place. Êtes-vous son aide de camp ?
— Je ne l’ai jamais vu.
— L’aide de camp s’appelle Saint-Vincent et non pas Leuwen, dit le blessé comme se parlant à lui-même… Il y a une chose que j’aimerais mieux que votre argent.
— Dites.
— Si c’était un effet de votre bonté, je ne me laisserai panser que quand vous serez là… Le fils de M. Leuwen, le riche banquier qui entretient mademoiselle Des Brins, de l’Opéra… Car, voyez-vous, mon lieutenant, dit-il en élevant de nouveau la voix… quand ils verront que je ne veux pas boire leur opium… en me pansant, crac !… un coup de lancette est bien vite donné, là, dans le ventre. Et ça me brûle ! Ça me brûle !… Ça ne durera pas, ça ne peut pas durer. Pour demain, voulez-vous ordonner, car il me semble que vous commandez ici… Et pourquoi commandez-vous ? Et sans uniforme, encore !… Enfin, au moins pansé sous vos yeux… Et le grand chirurgien puissant, a-t-il dit oui ou non ? Voilà le fait. »
La tête s’embarrassait.
« Ne jasez pas, dit Lucien, et je vous prends sous ma protection. Je vais vous envoyer votre femme.⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/365]]==
— Vous êtes un bien brave homme… Le riche banquier Leuwen, avec mademoiselle Des Brins, ça ne triche pas… Mais le général N… ?
— Certainement, je ne triche pas. Et tenez, ne parlez jamais du général N…, ni de personne, et voilà dix napoléons.
— Comptez-les-moi dans la main… Lever la tête me fait trop mal au ventre. »
Lucien compta les napoléons à voix basse, et en les faisant sentir comme il les mettait dans la main du blessé.
« Motus, dit celui-ci.
— Motus, bien dit. Si vous parlez, on vous vole vos napoléons. Ne parlez qu’à moi, et quand nous sommes seuls. Je viendrai vous voir tous les jours jusqu’à ce que vous soyez en convalescence. »
Il passa encore quelques instants auprès du blessé, dont la tête semblait se perdre. Il courut ensuite dans la rue de Braque, où logeait Kortis. Il trouva madame Kortis entourée de commères, qu’il eut assez de peine à faire retirer.
Cette femme se mit à pleurer, voulut montrer à Lucien ses enfants, qui dormaient paisiblement.
« Ceci est moitié nature, moitié comédie, pensa Lucien. Il faut la laisser parler, et qu’elle se lasse. »
Après vingt minutes de monologue et de précautions ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/366]]==⏎
oratoires infinies, car le peuple de Paris a pris à la bonne compagnie sa haine pour les idées présentées brusquement, madame Kortis parla d’opium ; Lucien écouta cinq minutes d’éloquence conjugale et maternelle sur l’opium.
« Oui, dit Lucien négligemment, on dit que les républicains ont voulu donner de l’opium à votre mari. Mais le gouvernement du roi veille sur tous les citoyens. À peine ai-je eu reçu votre lettre que j’ai mené sept médecins ou chirurgiens auprès du lit de votre mari. Et voici leur consultation », dit-il en plaçant le papier dans les mains de madame Kortis.
Il vit qu’elle ne savait pas trop lire.
« Qui osera maintenant donner de l’opium à votre mari ? Toutefois, il est préoccupé de cette idée, cela peut empirer son état…
— C’est un homme confisqué, dit-elle assez froidement.
— Non, madame ; puisqu’il n’y a pas eu gangrène dans les vingt-quatre heures, il peut fort bien en revenir. Le général Michaud a eu la même blessure. Etc., etc.
« Mais il ne faut pas parler d’opium, tout cela ne sert qu’à envenimer les partis. Il ne faut pas que Kortis jase. D’ailleurs, donnez le soin de vos enfants à une voisine à laquelle vous passerez quarante sous ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/367]]==⏎
par jour ; je vais payer la semaine d’avance. Vous, madame, vous pouvez aller vous établir auprès du lit de votre mari. »
À ce mot, toute l’éloquence de la physionomie pathétique de madame Kortis sembla l’abandonner. Lucien continua :
« Votre mari ne boira rien, ne prendra rien, que vous ne l’ayez préparé de vos propres mains…
— Dame ! monsieur, un hôpital, c’est bien dégoûtant… D’ailleurs mes pauvres enfants, mes orphelins, loin des yeux d’une mère comment seront-ils soignés ?… Etc., etc.
— Comme vous voudrez, madame, vous êtes si bonne mère !… Ce qui me fâche, c’est qu’on peut le voler…
— Qui ?
— Votre mari.
— Le plus souvent ! Je lui ai pris vingt-deux livres et sept sous qu’il avait sur lui. Je lui ai rempli sa tabatière, à ce pauvre cher homme, et j’ai donné dix sous à l’infirmier…
— À la bonne heure ! Rien de plus sage… Mais sous la condition qu’il ne bavardera pas politique, qu’il ne parlera pas d’opium, ni lui, ni vous, j’ai remis à M. Kortis douze napoléons.
— Des napoléons d’or ? interrompit madame Kortis d’une voix aigre.⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/368]]==
— Oui, madame, deux cent quarante francs, dit Lucien avec beaucoup d’indifférence.
— Et il ne faut pas qu’il jase ?…
— Si je suis content de lui et de vous, je vous passerai un napoléon chaque jour.
— Je dis vingt francs ? dit madame Kortis avec des yeux extrêmement ouverts.
— Oui, vingt francs, si vous ne parlez jamais d’opium. D’ailleurs moi, tel que vous me voyez, j’ai pris de l’opium pour une blessure, et on ne voulait pas me tuer. Toutes ces idées sont des chimères. Enfin, si vous parlez, si cela est imprimé123 dans quelque journal que Kortis a craint l’opium ou a parlé de sa blessure et de sa dispute avec le conscrit sur le pont d’Austerlitz, plus de vingt francs ; autrement, si vous ni lui ne jasez, vingt francs par jour.
— À compter de quand ?
— De demain.
— Si c’est un effet de votre bonté, à compter de ce soir, et avant minuit je vais à l’hôpital. Le pauvre cher homme, il n’y a que moi qui puisse l’empêcher de jaser… Madame Morin ! madame Morin ! » dit madame Kortis en criant…⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/369]]==
C’était une voisine à laquelle Lucien compta quatorze francs pour soigner les enfants pendant sept jours. Leuwen donna aussi quarante sous pour le fiacre qui allait conduire madame Kortis à l’hôpital de…
[Il sembla à Lucien qu’il s’était servi de façons de parler qui, étant répétées, ne pouvaient nullement prouver qu’il était complice de la proposition d’opium.
En quittant la rue de Braque, Lucien était heureux. Il avait supposé au contraire qu’il serait horriblement malheureux jusqu’à la fin de cette affaire.
« Je côtoie le mépris public, et la mort, se répétait-il souvent, mais j’ai bien mené ma barque. » ]
Chapitre XLVI.⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/370]]==
Enfin, comme onze heures trois quarts sonnaient, Lucien remonta dans son cabriolet. Il s’aperçut qu’il mourait de faim : il n’avait pas dîné et presque toujours parlé.
« Actuellement, il faut chercher mon ministre. »
Il ne le trouva pas à l’hôtel de la rue de Grenelle. Il écrivit un mot, fit changer le cheval du cabriolet et le domestique, et alla au ministère des Finances ; M. de Vaize en était sorti depuis longtemps.
« C’est assez de zèle comme cela, pensa Lucien. » Et il s’arrêta dans un café pour dîner. Il remonta en voiture après quelques minutes et fit deux courses inutiles dans la Chaussée d’Antin. Comme il passait devant le ministère des Affaires étrangères, il eut l’idée de faire frapper. Le portier répondit que M. le ministre de l’Intérieur était chez Son Excellence.
L’huissier ne voulait pas annoncer Leuwen et interrompre la conférence des deux Excellences. Lucien, qui savait qu’il ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/371]]==⏎
y avait une porte dérobée, eut peur que son ministre ne lui échappât ; il était las de courir et n’avait pas envie de retourner à la rue de Grenelle. Il insista, l’huissier refusa avec hauteur, Lucien se mit en colère.
« Parbleu, monsieur, j’ai l’honneur de vous répéter que je suis porteur de l’ordre exprès de M. le ministre de l’Intérieur. J’entrerai. Appelez la garde si vous voulez, mais j’entrerai de force. J’ai l’honneur de vous répéter que je suis M. Leuwen, maître des requêtes… »
Quatre ou cinq domestiques étaient accourus sur la porte du salon. Lucien vit qu’il allait avoir à combattre cette canaille, il était fort attrapé et fort en colère. Il eut l’idée d’arracher les cordons des deux sonnettes à force de sonner.
Au mouvement de respect que firent les laquais, il s’aperçut que M. le comte de Beausobre, ministre des Affaires étrangères, entrait dans le salon. Lucien ne l’avait jamais vu.
« Monsieur le comte, je me nomme Leuwen, maître des requêtes. J’ai un million d’excuses à demander à Votre Excellence. Mais je cherche M. le comte de Vaize depuis deux heures, et par son ordre exprès ; il faut que je lui parle pour une affaire importante et pressée.
— Quelle affaire… pressée », dit le ministre ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/372]]==⏎
avec une fatuité rare et en redressant sa petite personne.
« Parbleu, je vais te faire changer de ton », pensa Lucien. Et il ajouta d’un grand sang-froid et avec une prononciation marquée :
« L’affaire Kortis, monsieur le comte, cet homme blessé sur le pont d’Austerlitz par un soldat qu’il voulait désarmer.
— Sortez », dit le ministre aux valets. Et, comme l’huissier restait : « Sortez donc ! »
L’huissier sorti, il dit à Leuwen :
« Monsieur, le mot Kortis eût suffi sans les explications. (L’impertinence du ton de voix et des mouvements était rare.)
— Monsieur le comte, je suis nouveau dans les affaires, dit Lucien d’un ton marqué. Dans la société de mon père, M. Leuwen, je n’ai pas été accoutumé à être reçu avec l’accueil que Votre Excellence me faisait. J’ai voulu faire cesser aussi rapidement que possible un état de choses désagréable et peu convenable.
— Comment, monsieur, peu convenable ? dit le ministre en prononçant du nez, relevant la tête encore plus et redoublant d’impertinence. Mesurez vos paroles.
— Si vous en ajoutez une seule sur ce ton, monsieur le comte, je donne ma démission et nous mesurerons nos épées. La fatuité, monsieur, ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/373]]==⏎
ne m’en a jamais imposé. »
M. de Vaize venait d’un cabinet éloigné savoir ce qui se passait ; il entendit les derniers mots de Lucien et vit que lui, de Vaize, pouvait être la cause indirecte du bruit.
« De grâce, mon ami, de grâce, dit-il à Lucien. Mon cher collègue, c’est un jeune officier, dont je vous parlais. N’allons pas plus loin.
— Il n’y a qu’une façon de ne pas aller plus loin, dit Lucien avec un sang-froid qui cloua les ministres dans le silence. Il n’y a absolument qu’une façon, répéta-t-il d’un air glacial : c’est de ne pas ajouter un seul petit mot sur cet incident, et de supposer que l’huissier m’a annoncé à Vos Excellences.
— Mais, monsieur dit M. de Beausobre, ministre des Affaires étrangères, en se redressant excessivement.
— J’ai un million de pardons à demander à Votre Excellence ; mais si elle ajoute un mot, je donne ma démission à M. de Vaize que voilà, et je vous insulte, vous, monsieur, de façon à rendre une réparation nécessaire à vous.
— Allons-nous-en, allons-nous-en ! » s’écria M. de Vaize fort troublé et entraînant Lucien. Celui-ci prêtait l’oreille pour entendre ce que dirait M. le comte de… Il n’entendit rien.
Une fois en voiture, ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/374]]==⏎
il pria M. de Vaize, qui commençait un discours dans le genre paternel, de lui permettre de lui rendre compte d’abord de l’affaire Kortis. Ce compte rendu fût très long. En le commençant, Lucien avait parlé du procès-verbal et de la consultation. À la fin du récit, le ministre lui demanda ces pièces.
« Je vois que je les ai oubliées chez moi », dit Lucien. « Si le comte de Beausobre veut faire le méchant, avait-il pensé, ces pièces peuvent prouver que j’avais raison de vouloir rendre un compte immédiat au ministre de l’Intérieur, et que je ne suis pas un solliciteur forçant la porte. »
Comme on arrivait dans la rue de Grenelle, l’affaire Kortis étant finie, M. le comte de Vaize essaya de revenir à l’éloquence onctueuse et paternelle.
« Monsieur le comte, dit Lucien en l’interrompant, je travaille pour Votre Excellence depuis cinq heures du soir. Une heure sonne, souffrez que je monte dans mon cabriolet, qui suit votre carrosse. Je suis mort de fatigue. »
M. de Vaize voulut revenir au genre paternel.
« N’ajoutons pas un mot sur l’incident, dit Lucien ; un seul petit mot peut tout envenimer. »
Le ministre se laissa quitter ainsi ; Lucien monta ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/375]]==⏎
en cabriolet, et dit à son domestique de monter et de conduire : il était réellement très fatigué. En passant sur le pont Louis XV, son domestique lui dit :
« Voilà le ministre. »
« Il retourne chez son collègue malgré l’heure avancée, et sûrement je vais faire les frais de la conversation. Parbleu, je ne tiens pas à ma place ; mais s’ils me destituent, je force ce fat à mettre l’épée à la main. Ces messieurs peuvent être mal élevés et impertinents tant qu’il leur plaira, mais il faut choisir les gens. Avec des Desbacs qui veulent faire fortune à tout prix, à la bonne heure ; mais avec moi, c’est impossible. »
En rentrant, Lucien trouva son père, le bougeoir à la main, qui montait se coucher. Malgré l’envie passionnée d’avoir l’avis d’un homme de tant d’esprit :
« Par malheur, il est vieux, se dit Leuwen, et il ne faut pas l’empêcher de dormir. À demain les affaires. »
Le lendemain, à dix heures, il conta tout à son père, qui se mit à rire.
« M. de Vaize te mènera dîner demain chez son collègue des Affaires étrangères. Mais voilà assez de duels dans ta vie comme ça, maintenant ils seraient de mauvais ton pour toi… Ces messieurs se sont promis de te destituer dans deux mois, ou de te ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/376]]==⏎
faire nommer préfet à Briançon ou à Pondichéry. Mais si cette place éloignée ne te convient pas plus qu’à moi, je leur ferai peur et j’empêcherai cette disgrâce… Du moins, je le tenterai avec quelque apparence de succès. »
Le dîner chez Son Excellence des Affaires étrangères se fit attendre jusqu’au surlendemain, et dans l’intervalle Lucien, toujours très occupé de l’affaire Kortis, ne permit pas que M. de Vaize lui reparlât de l’incident.
Le lendemain du dîner, M. Leuwen père raconta l’anecdote à trois ou quatre diplomates. Il ne tut que le nom de Kortis et le genre de l’affaire importante qui obligeait Lucien à chercher son ministre à une heure du matin.
« Tout ce que je puis dire sur l’heure avancée, c’est que ce n’était pas une affaire de télégraphe », dit-il à l’ambassadeur de Russie.
Quelques jours après, M. Leuwen surprit dans le monde un léger bruit qui supposait que son fils était saint-simonien. Sur quoi, à l’insu de Lucien, il pria M. de Vaize de le conduire un jour chez son collègue des Affaires étrangères.
« Et pourquoi, cher ami ?
— Je tiens beaucoup à laisser à Votre Excellence le plaisir de cette surprise. » ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/377]]==⏎
Tout le long du chemin, en allant à cette audience, M. Leuwen se moqua de la curiosité de son ami le ministre.
Il commença sur un ton fort peu sérieux la conversation que Son Excellence des Affaires étrangères daignait lui accorder.
« Personne, monsieur le comte, ne rend plus de justice que moi à l’habileté de Votre Excellence ; mais il faut convenir aussi qu’elle a de grands moyens. Quarante personnages couverts de titres et de cordons, que je lui nommerais au besoin, cinq ou six grandes dames appartenant à la première noblesse et assez riches grâce aux bienfaits de Votre Excellence, peuvent faire l’honneur à mon fils Lucien Leuwen, maître des requêtes indigne, de s’occuper de lui. Ces personnages respectables peuvent répandre tout doucement qu’il est saint-simonien. On pourrait dire à aussi peu de frais qu’il a manqué de cœur dans une occasion essentielle. On pourrait faire mieux, et lui lâcher deux ou trois de ces personnages recommandables dont j’ai parlé qui, étant jeunes encore, cumulent et sont aussi bretteurs. Ou bien, si l’on voulait user d’indulgence et de bonté envers mes cheveux blancs, ces personnages, tels que M. le comte de…, M. de…, M. le baron de… qui a 40 000 francs de rente, M. le marquis…, pourraient se ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/378]]==⏎
borner à dire que ce petit Leuwen gagne toujours à l’écarté. Sur quoi, je viens, monsieur le comte, en votre qualité de ministre des Affaires étrangères, vous offrir la guerre ou la paix. »
M. Leuwen prit un malin plaisir à prolonger beaucoup l’entretien ainsi commencé. Au sortir de l’hôtel des Affaires étrangères, M. Leuwen alla chez le roi, duquel il avait obtenu une audience. Il répéta exactement au roi la conversation qu’il venait d’avoir avec son ministre des Affaires étrangères.
« Viens ici, dit M. Leuwen à son fils en rentrant chez lui, que je répète pour la seconde fois la conversation que j’ai eu l’honneur d’avoir avec les ministres auxquels tu manques de respect. Mais pour ne pas m’exposer à une troisième répétition, allons chez ta mère. »
À la fin de la conférence chez madame Leuwen, notre héros crut pouvoir hasarder un mot de remerciement à son père.
« Tu deviens commun, mon ami, sans t’en douter. Tu ne m’as jamais autant amusé que depuis un mois. Je te dois l’intérêt de jeunesse avec lequel je suis les affaires de bourse depuis quinze jours, car il fallait me mettre en position de jouer quelque bon tour à mes deux ministres s’ils se permettent à ton égard quelque trait de fatuité. Enfin, je t’aime, et ta mère te dira que jusqu’ici, ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/379]]==⏎
pour employer une phrase des livres ascétiques, je l’aimais en toi. Mais il faut payer mon amitié d’un peu de gêne.
— De quoi s’agit-il ?
— Suis-moi. »
Arrivé dans sa chambre :
« Il est capital de te laver de la calomnie qui t’impute d’être saint-simonien. Ton air sérieux, et même imposant, peut lui donner cours.
— Rien de plus simple : un bon coup d’épée…
— Oui, pour te donner la réputation de duelliste, presque aussi triste ! Je t’en prie, plus de duel sous aucun prétexte.
— Et que faut-il donc ?
— Un amour célèbre. »
Lucien pâlit.
« Rien de moins, continua son père. Il faut séduire madame Grandet, ou, ce qui serait plus cher mais peut-être moins ennuyeux, faire des folies d’argent pour mademoiselle Julie, ou mademoiselle Gosselin, ou mademoiselle…, et passer quatre heures tous les jours avec elle. Je ferai les frais de cette passion124.⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/380]]==
— Mais, mon père, est-ce que je n’ai pas déjà l’honneur d’être amoureux de mademoiselle Raimonde ?
— Elle n’est pas assez connue. Voici le dialogue : “Leuwen fils est décidément avec la petite Raimonde. — Et qu’est-ce que c’est que mademoiselle Raimonde ?…” “Il faut qu’il soit ainsi : “Leuwen fils est actuellement avec mademoiselle Gosselin. — Ah diable ! et est-il amant en pied ? — Il en est fou jaloux… Il veut être seul.” »
« Et, de plus, il faut forcément que je te présente dans dix maisons au moins où l’on tâtera le pouls à ta tristesse saint-simonienne. »
Cette alternative de madame Grandet ou de mademoiselle Gosselin embarrassa beaucoup Leuwen.
L’affaire Kortis s’était fort bien terminée, et le comte de Vaize lui avait fait des compliments. Cet agent trop zélé n’était mort qu’au bout de huit jours et n’avait pas parlé.
Lucien demanda au ministre un congé de quatre jours pour terminer quelques affaires d’intérêt à Nancy. Il se sentait depuis quelque temps une envie folle de revoir la petite fenêtre de madame de Chasteller. Après avoir obtenu le congé du ministre, Lucien en parla à ses parents, ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/381]]==⏎
qui ne trouvèrent pas d’inconvénient à un petit voyage à Strasbourg ; jamais Lucien n’eut le courage de prononcer le nom de Nancy.
« Pour que ton absence ne paraisse pas longue, tous les jours de soleil, vers les deux heures, j’irai voir ton ministre », dit M. Leuwen.
Lucien était encore à dix lieues de Nancy que son cœur battait à l’incommoder. Il ne respirait plus d’une façon naturelle. Comme il fallait entrer de nuit dans Nancy et n’être vu de personne, Lucien s’arrêta à un village situé à une lieue. Même à cette distance, il n’était pas maître de ses transports ; il n’entendait pas de loin une charrette sur les chemins, qu’il ne crût reconnaître le bruit de la voiture de madame de Chasteller…125
« — J’ai gagné bien de l’argent par ton télégraphe, dit M. Leuwen à son fils, et jamais ta présence n’eût été plus nécessaire. »
Lucien trouva à dîner chez son père son ami Ernest Dévelroy. Il était fort triste : ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/382]]==⏎
son savant moral, qui lui avait promis quatre voix à l’Académie des Sciences politiques, était mort aux eaux de Vichy, et après l’avoir dûment enterré, Ernest s’était aperçu qu’il venait de perdre quatre mois de soins ennuyeux et de gagner un ridicule.
« Car il faut réussir, disait-il à Lucien. Et parbleu, si jamais je me dévoue à un membre de l’Institut, je le prendrai de meilleure santé ! »
Lucien admirait le caractère de son cousin : il ne fut triste que huit jours, et puis fit un nouveau plan et recommença sur nouveaux frais. Ernest disait dans les salons :
« Je devais quelques jours de regrets sans limites à la mémoire du savant Descors. L’amitié de cet excellent homme et sa perte feront époque dans ma vie, il m’a appris à mourir… J’ai vu le sage à sa dernière heure entouré des consolations du christianisme ; c’est auprès du lit d’un mourant qu’il faut apprécier cette religion… Etc., etc. »
Peu de jours après sa rentrée dans le monde, Ernest dit à Leuwen :
« Tu as une grande passion. (Lucien pâlit.) Parbleu ! tu es bien heureux : on s’occupe de toi ! Il ne s’agit plus que de deviner l’objet. Je ne te demande rien, ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/383]]==⏎
je te dirai bientôt quels sont les beaux yeux qui t’ont enlevé ta gaieté. Fortuné Lucien, tu occupes le public ! Ah ! grand Dieu ! qu’on est heureux d’être né d’un père qui donne à dîner et qui voit M. Pozzo di Borgo et la haute diplomatie ! Si j’avais un tel père, je serais pour tout cet hiver le héros de l’amitié, et la mort de Descors dans mes bras me serait peut-être plus utile que sa vie. Faute d’un père tel que le tien, je fais des miracles, et tout cela ne compte pas, ou ne compte que pour me faire appeler intrigant. »
Lucien trouva le même bruit sur son compte chez trois dames, anciennes amies de sa [mère], qui avaient des salons du second ordre où il était reçu avec amitié.
Le petit Desbacs, auquel il donna exprès quelques libertés de parler de choses étrangères aux affaires, lui avoua que les personnes les mieux instruites parlaient de lui comme d’un jeune homme destiné aux plus grandes choses, mais arrêté tout court par une grande passion.
« Ah ! mon cher, que vous êtes heureux, surtout si vous n’avez pas cette grande passion ! Quel parti ne pouvez-vous pas en tirer ? Ce vernis vous rend pour longtemps imperméable au ridicule. »
Lucien se défendait du mieux qu’il pouvait, mais il se dit :⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/384]]==
« Mon malheureux voyage à Nancy a tout découvert. »
Il était loin de deviner qu’il devait cette grande passion à son père, qui réellement, depuis l’aventure du ministre des Affaires étrangères, avait pris de l’amitié pour lui, jusqu’au point d’aller à la Bourse même les jours froids et humides, chose à laquelle, depuis le jour où il avait eu soixante ans, rien au monde n’avait pu le déterminer126.
« Il finira par me prendre en guignon, disait-il à madame Leuwen, si je le dirige trop et lui parle sans cesse de ses affaires. Je dois me garder du rôle de père, si ennuyeux pour le fils quand le père s’ennuie ou quand il aime vivement. »
La tendresse timide de madame Leuwen s’opposa de toute sa force à ce qu’il affublât son fils d’une grande passion ; elle voyait dans ce bruit une source de dangers.
« Je voudrais pour lui, disait-elle, une vie tranquille et non brillante.
— Je ne puis, répondait M. Leuwen, je ne puis, en conscience. Il faut qu’il ait une grande passion, ou tout ce sérieux que vous prisez tant tournerait contre lui, ce ne serait qu’un plat saint-simonien, et qui sait même, plus tard, à trente ans, un inventeur de quelque nouvelle religion. Tout ce que je puis faire, c’est de lui laisser le choix de la belle pour laquelle il aura ce grand et sérieux attachement. Sera-ce madame de Chasteller, madame Grandet, mademoiselle Gosselin, ou cette ignoble petite Raimonde, une actrice à 6 000 francs de gages ? » (il n’ajoutait pas la fin de sa pensée… : et qui, toute la journée, se permet des épigrammes sur mon compte, car mademoiselle Raimonde avait beaucoup plus d’esprit que mademoiselle Des Brins et la voyait souvent.)
« Ah ! ne prononcez pas le nom de madame de Chasteller ! s’écria madame Leuwen. Vous lui feriez faire de vraies folies. »
M. Leuwen songeait à mesdames de Thémines et Toniel, ses amies depuis vingt ans et toutes deux fort liées avec madame Grandet. Depuis bien des années il prenait soin de la fortune de M. de Thémines ; c’est un grand service à Paris et pour lequel la reconnaissance est sans bornes, car, dans la déroute des dignités et de la noblesse d’origine, l’argent est resté la seule chose, et l’argent sans inquiétude est la belle chose des belles choses. Il alla leur demander des nouvelles du cœur de madame Grandet.
Nous ôterons à leurs réponses les formes trop longues de la narration, et même nous réunirons les renseignements donnés par les deux dames, qui vivaient dans le même hôtel et n’avaient qu’une voiture, mais ne se disaient pas tout. Madame Toniel avait du caractère, mais, une certaine âpreté, elle était le conseil de madame Grandet dans les grandes circonstances. Pour madame de Thémines, elle avait une douceur infinie, beaucoup d’à-propos dans l’esprit, et était l’arbitre souverain de ce qui convient ou ne convient pas ; sa lunette ne voyait pas très au loin, mais elle apercevait parfaitement ce qui était à sa portée. Née dans la haute société, elle avait fait des fautes qu’elle avait su réparer, et il y avait quarante ans qu’elle ne se trompait guère dans les jugements qu’elle portait sur l’effet que devaient produire les choses dans les salons de Paris. Depuis quatre ans, sa sérénité était un peu troublée par deux malheurs : l’apparition dans la société de noms qu’on n’eût dû jamais y voir ou qu’on n’eût jamais dû voir annoncés par des laquais de bonne maison, et le chagrin de ne plus voir de places dans les régiments à tous ces jeunes gens de bonne maison qui avaient été autrefois les amis de ses petits-fils que depuis longtemps elle avait perdus.
M. Leuwen père, qui voyait madame de Thémines une fois la semaine ou chez lui ou chez elle, pensa qu’il fallait auprès d’elle prendre le rôle de père au sérieux. Il alla plus loin, il jugea qu’à son âge il pouvait entreprendre de la tromper net et de supprimer, dans l’histoire de son fils, le nom de madame de Chasteller. Il fit des aventures de son fils une histoire fort jolie et, après avoir amusé madame de Thémines pendant toute la fin d’une soirée, finit par lui avouer des inquiétudes sérieuses sur son fils qui, depuis trois mois qu’il était admis dans le salon de madame Grandet, était d’une tristesse mortelle ; il craignait un amour pris au sérieux, ce qui dérangerait tous ses projets pour ce fils chéri. Car il faut le marier… Etc.
« Ce qu’il y a de singulier, lui dit madame de Thémines, c’est que depuis son retour d’Angleterre madame Grandet est fort changée ; il y a aussi du chagrin dans cette tête-là. »
Mais, pour prendre les choses par ordre, voici ce que M. Leuwen apprit de mesdames de Thémines et Toniel, qu’il vit séparément et ensuite réunies, et nous y ajouterons tout de suite ce que des mémoires particuliers nous ont appris sur cette femme célèbre127.
Madame Grandet se voyait à peu près la plus jolie femme de Paris, ou du moins on ne pouvait citer les six plus jolies femmes sans la mettre du nombre. Ce qui brillait surtout en elle, c’était une taille élancée, souple, charmante. Elle avait les plus beaux cheveux blonds du monde et beaucoup de grâce à cheval, où elle ne manquait pas de courage. C’était une beauté élancée et blonde comme les jeunes Vénitiennes de Paul Véronèse. Les traits étaient jolis, mais pas très distingués. Pour son cœur, il était à peu près l’opposé de ce que l’on se figure comme étant le cœur italien. Le sien était parfaitement étranger à tout ce que l’on appelle émotions tendres et enthousiasme, et cependant elle passait sa vie à jouer ces sentiments. Lucien l’avait trouvée dix fois s’apitoyant sur les infortunes de quelque prêtre prêchant l’évangile à la Chine, ou sur la misère de quelque famille appartenant dans sa province à tout ce qu’il y a de mieux. Mais dans le secret du cœur de madame Grandet rien ne lui semblait bas, ridicule, bourgeois en un mot, comme d’être attendrie. Elle voyait en cela la marque la plus sûre d’une âme faible. Elle lisait souvent les Mémoires du cardinal de Retz : ils avaient pour elle le charme qu’elle cherchait vainement dans les romans. Le rôle politique de mesdames de Longueville et de Chevreuse était pour elle ce que sont les aventures de tendresse et de danger pour un jeune homme de dix-huit ans.
« Quelles positions admirables, se disait madame Grandet, si elles eussent su se garantir de ces erreurs de conduite qui donnent tant de prise sur nous ! »
L’amour même, dans ce qu’il a de plus réel, ne lui semblait qu’une corvée, qu’un ennui. C’était peut-être à cette tranquillité d’âme128 qu’elle devait son étonnante fraîcheur, ce teint admirable qui la mettait en état de lutter avec les plus belles Allemandes, et un air de jeunesse et de santé qui était comme une fête pour les yeux. Aussi aimait-elle à se laisser voir à neuf heures du matin, au sortir de son lit. C’est alors surtout qu’elle était incomparable ; il fallait songer au ridicule du mot pour résister au plaisir de la comparer à l’aurore. Aucune de ses rivales ne pouvait approcher d’elle sous le rapport de la fraîcheur des teintes. Aussi son bonheur était-il de prolonger jusqu’au grand jour les bals qu’elle donnait et de faire déjeuner les danseurs au soleil, les volets ouverts. Si quelque jolie femme, sans se douter de ce coup de Jarnac, était restée, à l’étourdie, entraînée par le plaisir de la danse, madame Grandet triomphait ; c’était le seul moment dans la vie où son âme perdît terre, et ces humiliations de ses rivales étaient l’unique chose à quoi sa beauté lui semblât bonne. La musique, la peinture, l’amour, lui semblaient des niaiseries inventées par et pour les petites âmes. Et elle passait sa vie à goûter un plaisir sérieux, disait-elle, dans sa loge aux Bouffes, car, avait-elle soin d’ajouter, les chanteurs italiens ne sont pas excommuniés. Le matin, elle peignait des aquarelles avec un talent vraiment fort distingué ; cela lui semblait aussi nécessaire à une femme du grand monde qu’un métier à broder, et bien moins ennuyeux. Une chose marquait qu’elle n’avait pas l’âme noble, c’était l’habitude, et presque la nécessité, de se comparer à quelque chose ou à quelqu’un pour s’estimer ou se juger, par exemple aux nobles dames du faubourg Saint-Germain.
Elle avait engagé son mari à la conduire en Angleterre pour voir si elle trouverait une blonde qui eût plus de fraîcheur, et pour ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/385]]==
et qui sait même, plus tard, à trente ans, un inventeur de quelque nouvelle religion. Tout ce que je puis faire, c’est de lui laisser le choix de la belle pour laquelle il aura ce grand et sérieux attachement. Sera-ce madame de Chasteller, madame Grandet, mademoiselle Gosselin, ou cette ignoble petite Raimonde, une actrice à 6 000 francs de gages ? » (il n’ajoutait pas la fin de sa pensée… : et qui, toute la journée, se permet des épigrammes sur mon compte, car mademoiselle Raimonde avait beaucoup plus d’esprit que mademoiselle Des Brins et la voyait souvent.)
« Ah ! ne prononcez pas le nom de madame de Chasteller ! s’écria madame Leuwen. Vous lui feriez faire de vraies folies. »
M. Leuwen songeait à mesdames de Thémines et Toniel, ses amies depuis vingt ans et toutes deux fort liées avec madame Grandet. Depuis bien des années il prenait soin de la fortune de M. de Thémines ; c’est un grand service à Paris et pour lequel la reconnaissance est sans bornes, car, dans la déroute des dignités et de la noblesse d’origine, l’argent est resté la seule chose, et l’argent sans inquiétude est la belle chose des belles choses. Il alla leur demander des nouvelles du cœur de madame Grandet.
Nous ôterons à leurs réponses les formes
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/386]]==
trop longues de la narration, et même nous réunirons les renseignements donnés par les deux dames, qui vivaient dans le même hôtel et n’avaient qu’une voiture, mais ne se disaient pas tout. Madame Toniel avait du caractère, mais, une certaine âpreté, elle était le conseil de madame Grandet dans les grandes circonstances. Pour madame de Thémines, elle avait une douceur infinie, beaucoup d’à-propos dans l’esprit, et était l’arbitre souverain de ce qui convient ou ne convient pas ; sa lunette ne voyait pas très au loin, mais elle apercevait parfaitement ce qui était à sa portée. Née dans la haute société, elle avait fait des fautes qu’elle avait su réparer, et il y avait quarante ans qu’elle ne se trompait guère dans les jugements qu’elle portait sur l’effet que devaient produire les choses dans les salons de Paris. Depuis quatre ans, sa sérénité était un peu troublée par deux malheurs : l’apparition dans la société de noms qu’on n’eût dû jamais y voir ou qu’on n’eût jamais dû voir annoncés par des laquais de bonne maison, et le chagrin de ne plus voir de places dans les régiments à tous ces jeunes gens de bonne maison qui avaient été autrefois les amis de ses petits-fils que depuis longtemps elle avait perdus.
M. Leuwen père, qui voyait madame de Thémines une fois
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/387]]==
la semaine ou chez lui ou chez elle, pensa qu’il fallait auprès d’elle prendre le rôle de père au sérieux. Il alla plus loin, il jugea qu’à son âge il pouvait entreprendre de la tromper net et de supprimer, dans l’histoire de son fils, le nom de madame de Chasteller. Il fit des aventures de son fils une histoire fort jolie et, après avoir amusé madame de Thémines pendant toute la fin d’une soirée, finit par lui avouer des inquiétudes sérieuses sur son fils qui, depuis trois mois qu’il était admis dans le salon de madame Grandet, était d’une tristesse mortelle ; il craignait un amour pris au sérieux, ce qui dérangerait tous ses projets pour ce fils chéri. Car il faut le marier… Etc.
« Ce qu’il y a de singulier, lui dit madame de Thémines, c’est que depuis son retour d’Angleterre madame Grandet est fort changée ; il y a aussi du chagrin dans cette tête-là. »
Mais, pour prendre les choses par ordre, voici ce que M. Leuwen apprit de mesdames de Thémines et Toniel, qu’il vit séparément et ensuite réunies, et nous y ajouterons tout de suite ce que des mémoires particuliers nous ont appris sur cette femme célèbre127.
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/388]]==
Madame Grandet se voyait à peu près la plus jolie femme de Paris, ou du moins on ne pouvait citer les six plus jolies femmes sans la mettre du nombre. Ce qui brillait surtout en elle, c’était une taille élancée, souple, charmante. Elle avait les plus beaux cheveux blonds du monde et beaucoup de grâce à cheval, où elle ne manquait pas de courage. C’était une beauté élancée et blonde comme les jeunes Vénitiennes de Paul Véronèse. Les traits étaient jolis, mais pas très distingués. Pour son cœur, il était à peu près l’opposé de ce que l’on se figure comme étant le cœur italien. Le sien était parfaitement étranger à tout ce que l’on appelle émotions tendres et enthousiasme, et cependant elle passait sa vie à jouer ces sentiments. Lucien l’avait trouvée dix fois s’apitoyant sur les infortunes de quelque prêtre prêchant l’évangile à la Chine, ou sur la misère de quelque famille appartenant dans sa province à tout ce qu’il y a de mieux. Mais dans le secret du cœur de madame Grandet rien ne lui semblait bas, ridicule, bourgeois en un mot, comme d’être attendrie. Elle voyait en cela la marque la plus sûre d’une âme faible.
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/389]]==
Elle lisait souvent les Mémoires du cardinal de Retz : ils avaient pour elle le charme qu’elle cherchait vainement dans les romans. Le rôle politique de mesdames de Longueville et de Chevreuse était pour elle ce que sont les aventures de tendresse et de danger pour un jeune homme de dix-huit ans.
« Quelles positions admirables, se disait madame Grandet, si elles eussent su se garantir de ces erreurs de conduite qui donnent tant de prise sur nous ! »
L’amour même, dans ce qu’il a de plus réel, ne lui semblait qu’une corvée, qu’un ennui. C’était peut-être à cette tranquillité d’âme128 qu’elle devait son étonnante fraîcheur, ce teint admirable qui la mettait en état de lutter avec les plus belles Allemandes, et un air de jeunesse et de santé qui était comme une fête pour les yeux. Aussi aimait-elle à se laisser voir à neuf heures du matin, au sortir de son lit. C’est alors surtout qu’elle était incomparable ; il fallait songer au ridicule du mot pour résister au plaisir de la comparer à l’aurore. Aucune de ses rivales ne pouvait approcher d’elle sous le rapport de la fraîcheur des teintes. Aussi son bonheur était-il de
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/390]]==
prolonger jusqu’au grand jour les bals qu’elle donnait et de faire déjeuner les danseurs au soleil, les volets ouverts. Si quelque jolie femme, sans se douter de ce coup de Jarnac, était restée, à l’étourdie, entraînée par le plaisir de la danse, madame Grandet triomphait ; c’était le seul moment dans la vie où son âme perdît terre, et ces humiliations de ses rivales étaient l’unique chose à quoi sa beauté lui semblât bonne. La musique, la peinture, l’amour, lui semblaient des niaiseries inventées par et pour les petites âmes. Et elle passait sa vie à goûter un plaisir sérieux, disait-elle, dans sa loge aux Bouffes, car, avait-elle soin d’ajouter, les chanteurs italiens ne sont pas excommuniés. Le matin, elle peignait des aquarelles avec un talent vraiment fort distingué ; cela lui semblait aussi nécessaire à une femme du grand monde qu’un métier à broder, et bien moins ennuyeux. Une chose marquait qu’elle n’avait pas l’âme noble, c’était l’habitude, et presque la nécessité, de se comparer à quelque chose ou à quelqu’un pour s’estimer ou se juger, par exemple aux nobles dames du faubourg Saint-Germain.
Elle avait engagé son mari à la conduire en Angleterre pour voir si elle trouverait une blonde qui eût plus de fraîcheur, et pour
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/391]]==⏎
savoir si elle aurait peur à cheval. Elle avait trouvé dans les élégants country seats où elle avait été invitée l’ennui, mais non le sentiment de la crainte.
Quand Lucien lui fut présenté, elle revenait d’Angleterre, et son séjour en ce pays venait d’envenimer le sentiment d’admiration voisin de l’envie qu’elle éprouvait pour la noblesse d’origine ; son âme n’avait pas la supériorité qu’il faut pour chercher l’estime des gens qui estiment peu la noblesse. Madame Grandet n’avait été en Angleterre que la femme d’un des juste-milieu de Juillet les plus distingués par la faveur de Louis-Philippe, mais à chaque instant elle s’était sentie une femme de marchand. Ses cent mille livres de rente, qui la tiraient si fort du pair à Paris, en Angleterre n’étaient presque qu’une vulgarité de plus. Elle revenait d’Angleterre avec ce grand souci : « Il faut n’être plus une femme de marchand, et devenir une Montmorency. »
Son mari était un gros et grand homme de quarante ans, fort bien portant, et il n’y avait pas de veuvage à espérer. Même elle ne s’arrêta pas à cette idée : sa grande fortune l’avait éloignée de bonne heure, et par orgueil, des voies obliques, et elle méprisait tout ce qui était crime. Il s’agissait de devenir une Montmorency ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/392]]==⏎
sans rien se permettre que l’on ne pût avouer. C’était comme la diplomatie de Louis XIV quand il était heureux.
Son mari, colonel de la garde nationale, avait bien remplacé les Rohan et les Montmorency, politiquement parlant, mais quant à elle, personnellement, sa fortune était encore à faire.
Qu’est-ce qu’une Montmorency, à peine âgée de vingt-trois ans et avec une immense fortune ferait de son bonheur ?
Et même, ce n’était pas encore là toute la question :
Ne fallait-il pas faire encore autre chose pour arriver à être regardée dans le monde, à peu près comme cette Montmorency l’eût été ?
Une haute et sublime dévotion, ou bien avoir de l’esprit comme madame de Staël, ou bien une illustre amitié ; devenir l’amie intime de la reine ou de madame Adélaïde et une sorte de madame de Polignac de 1785, être ainsi à la tête de la cour des femmes et donner des soupers à la reine ; ou bien il fallait au moins une illustre amitié dans le faubourg Saint-Germain.
Toutes ces possibilités, tous ces partis, occupaient tour à tour son esprit et l’accablaient, car elle avait plus de persévérance et de courage que d’esprit. Et elle ne savait pas se ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/393]]==⏎
faire aider ; elle avait bien deux amies, mesdames de Thémines et Toniel, mais elle n’accordait sa confiance que pour une partie seulement des projets qui l’empêchaient de dormir. Plusieurs des idées dont nous avons parlé, et des plus brillantes encore dont la possibilité absolue s’était présentée à son ambition, étaient hors de toute probabilité.
Quand Lucien lui fut présenté, il la trouva faisant la madame de Staël, et de là le dégoût que nous lui avons vu pour son effroyable bavardage à propos de tout et sur tous les sujets.
Un peu avant le voyage de Lucien à Nancy, madame Grandet, ne voyant rien se présenter pour la mise à exécution de ses grands projets, s’était dit :
« Ne serait-ce pas négliger un avantage actuel et perdre une grande chance de distinction que de ne pas inspirer quelque grand amour célèbre par le malheur de l’amoureux ? Ne serait-il pas admirable, dans toutes les suppositions, qu’un homme distingué allât voyager en Amérique pour m’oublier, moi qui ne lui accorderais jamais un instant d’attention ? »
Cette grande question avait été mûrement pesée sans le moindre grain de faiblesse féminine, et même d’autant plus sévèrement pesée qu’elle avait toujours été l’écueil ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/394]]==⏎
des femmes dont madame Grandet admirait le plus la fortune et la façon d’être dans le monde et la niche qu’elles s’étaient faites dans l’histoire.
« Ce serait négliger un avantage actuel et bien passager, s’était-elle dit enfin, que de ne pas inspirer une grande passion ; mais le choix est scabreux : que n’ai-je pas fait pour conquérir simplement pour ami un homme qui fût de haute naissance ? Les agréments, la jeunesse et, à plus forte raison, la fortune, n’ont rien été pour moi ; je ne voulais qu’un sang pur et une réputation sans tache. Mais aucun homme appartenant à l’ancienne noblesse de cour n’a voulu prendre ce rôle. Comment espérer d’en trouver un pour celui d’un être parfaitement infortuné, de l’amoureux, en un mot, de la femme d’un fabricant enrichi ? »
Ainsi se parlait madame Grandet. Elle avait cette force : elle ne ménageait point les termes en raisonnant avec soi-même ; c’était l’invention, c’était l’esprit proprement dit que l’on ne trouvait point chez elle. Elle repassait dans sa tête toutes les démarches et presque toutes les bassesses qu’elle avait faites. En vain avait-elle fait des bassesses pour voir plus souvent deux ou trois hommes de cette volée que le hasard avait fait paraître dans son salon, toujours après ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/395]]==⏎
deux ou trois mois ces nobles messieurs avaient rendu leurs visites plus rares.
Tout cela était vrai, il n’en était pas moins convenable d’inspirer une grande passion !
Ce fut dans ces circonstances intérieures, tout à fait inconnues à M. Leuwen père, qu’un matin madame de Thémines vint passer une heure avec sa jeune amie pour deviner si ce cœur était occupé de notre héros. Après avoir reconnu et ménagé l’état de sa vanité ou de son ambition, madame de Thémines lui dit :
« Vous faites des malheureux, ma belle, et bien vous choisissez.
— Je suis si éloignée de choisir, répondit fort sérieusement madame Grandet, que j’ignore jusqu’au nom du malheureux chevalier. Est-ce un homme de distinction ?
— La naissance seule lui manque.
— Trouve-t-on de vraiment bonnes manières sans naissance ? répondit-elle avec une sorte de découragement.
— Que j’aime le tact parfait qui vous distingue ! s’écria madame de Thémines. Malgré la plate adoration qu’on a pour l’esprit, pour cette eau-forte, cet acide de vitriol qui ronge tout, vous n’admettez point l’esprit comme compensation des bonnes manières. Ah ! que vous êtes des nôtres ! ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/396]]==⏎
Mais je croirais assez que votre victime nouvelle a des manières distinguées. Il est vrai qu’il est habituellement si triste depuis qu’il vient ici, qu’il n’est pas bien sûr d’en juger ; car c’est la gaieté d’un homme, c’est le genre de ses plaisanteries et sa manière de les dire qui marque sa place dans la société. Mais pourtant, si celui que vous rendez malheureux appartenait à une famille, on le placerait indubitablement au premier rang.
— Ah ! c’est M. Leuwen le maître des requêtes !
— Eh bien ! est-ce vous, ma belle, qui le conduirez au tombeau ?
— Ce n’est pas l’air malheureux que je lui trouve, dit madame Grandet, c’est l’air ennuyé. »
On ajouta à peine quelques mots. Madame de Thémines laissa tomber le discours sur la politique et dit, à propos de quelque chose :
« Ce qui est du dernier choquant et ce qui décide de tout, c’est la Bourse où votre mari ne va pas.
— Il y a plus de vingt mois qu’il n’y a mis les pieds, dit madame Grandet avec empressement.
— Ce sont les gens que vous recevez chez vous qui font et défont les ministres.
— Mais je suis bien loin de recevoir exclusivement ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/397]]==⏎
ces messieurs ! (Du même ton piqué.)
— Ne désertez pas une belle position, ma chère ! Et, entre nous, dit-on en baissant la voix, et d’un ton d’intimité, ne prenez pas pour l’apprécier les paroles des ennemis de cette position. Déjà une fois, sous Louis XIV, comme le rabâche sans cesse ce méchant duc de Saint-Simon, que vous aimez tant, les bourgeois ont pris le ministère. Qu’étaient Colbert, Séguier ? Et, à la longue, les ministres font la fortune de qui ils veulent. Et qui fait les ministres aujourd’hui ? Les Rothschild, les…, les…, les Leuwen. À propos, n’est-ce pas M. Pozzo di Borgo qui disait l’autre jour que M. Leuwen avait fait une scène à M. le ministre des Affaires étrangères à propos de son fils, ou bien c’est le fils qui, au milieu de la nuit, est allé faire une scène à ce ministre ? »
Madame Grandet dit tout ce qu’elle savait. C’était la vérité à peu près, mais racontée à l’avantage des Leuwen. Là encore, il n’y avait pas trace d’intérêt ou de relations particulières, plutôt de l’éloignement pour l’air ennuyé de Leuwen.
Le soir, madame de Thémines crut pouvoir rassurer M. Leuwen et lui dire qu’il n’y avait ni amour ni galanterie entre son fils et la belle madame Grandet.
Chapitre XLVII129.⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/398]]==
M. Leuwen père était un homme fort gros, qui avait le teint fleuri, l’œil vif, et de jolis cheveux gris bouclés. Son habit, son gilet étaient un modèle de cette élégance modeste qui convient à un homme âgé. On trouvait dans toute sa personne quelque chose de leste et d’animé. À son œil noir, à ses brusques changements de physionomie, on l’eût pris plutôt pour un peintre homme de génie (comme il n’y en a plus) que pour un banquier célèbre. Il paraissait dans beaucoup de salons, mais passait sa vie avec les diplomates gens d’esprit (il abhorrait les graves) et le corps respectable des danseuses de l’Opéra ; il était leur providence dans leurs petites affaires d’argent, tous les soirs on le trouvait au foyer de l’Opéra. Il faisait assez peu de cas de la société qui s’appelle bonne. L’impudence et le charlatanisme, sans lesquels on ne réussit pas, l’importunaient. Il ne craignait que deux choses ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/399]]==⏎
au monde : les ennuyeux, et l’air humide. Pour fuir ces deux pestes, il faisait des choses qui eussent donné des ridicules à tout autre, mais jusqu’à soixante-cinq ans qu’il avait maintenant, c’était lui qui donnait des ridicules, et n’en prenait pas. [Se] promenant sur le boulevard, son laquais lui donnait un manteau pour passer devant la rue de la Chaussée-d’Antin. Il changeait d’habit cinq ou six fois par jour au moins, suivant le vent qui soufflait, et avait pour cela des appartements dans tous les quartiers de Paris. Son esprit avait du naturel, de la verve, de l’indiscrétion aimable, plutôt que des vues fort élevées. Il s’oubliait quelquefois et avait besoin de s’observer pour ne pas tomber dans les genres imprudents ou indécents.
« Si vous n’aviez pas fait fortune dans le commerce de l’argent, lui disait sa femme qui l’adorait, vous n’eussiez pu réussir dans aucune autre carrière. Vous racontez une anecdote innocemment, et vous ne voyez pas qu’elle blesse mortellement deux ou trois prétentions.
— J’ai paré à ce désavantage : tout homme solvable est toujours sûr de trouver dans ma caisse mille francs offerts de bonne grâce. Enfin, depuis dix ans on ne me discute plus, on m’accepte. »
M. Leuwen ne disait jamais la vérité ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/400]]==⏎
qu’à sa femme, mais aussi il la lui disait toute ; elle était pour lui comme une seconde mémoire à laquelle il croyait plus qu’à la sienne propre. D’abord, il avait voulu s’imposer quelque réserve quand son fils était en tiers, mais cette réserve était incommode et gâtait l’entretien (madame Leuwen aimait à ne pas se priver de la présence de son fils) ; il le jugeait fort discret, il avait fini par tout dire devant lui.
L’intérieur de ce vieillard, dont les mots méchants faisaient tant de peur, était fort gai.
À l’époque où nous sommes, on trouva pendant quelques jours qu’il était triste, agité ; il jouait fort gros jeu le soir, il se permit même de jouer à la Bourse ; mademoiselle Des Brins donna deux soirées dansantes dont il fit les honneurs.
Un soir, à deux heures du matin, en revenant d’une de ces soirées, il trouva son fils qui se chauffait dans le salon, et son chagrin éclata.
« Allez pousser le verrou de cette porte. » Et comme Lucien revenait près de la cheminée : « Savez-vous un ridicule affreux dans lequel je suis tombé ? dit M. Leuwen avec humeur.
— Et lequel, mon père ? Je ne m’en serais jamais douté.⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/401]]==
— Je vous aime, et par conséquent, vous me rendez malheureux ; car la première des duperies, c’est d’aimer, ajouta-t-il en s’animant de plus en plus et prenant un ton sérieux que son fils ne lui avait jamais vu. Dans ma longue carrière je n’ai connu qu’une exception, mais aussi elle est unique. J’aime votre mère, elle est nécessaire à ma vie, et elle ne m’a jamais donné un grain de malheur. Au lieu de vous regarder comme mon rival dans son cœur, je me suis avisé de vous aimer, c’est un ridicule dans lequel je m’étais bien promis de ne jamais tomber, et vous m’empêchez de dormir. »
À ce mot, Lucien devint tout à fait sérieux. Son père n’exagérait jamais, et il comprit qu’il allait avoir affaire à un accès de colère réel.
M. Leuwen était d’autant plus irrité qu’il parlait à son fils après s’être promis quinze jours durant de ne pas lui dire un mot de ce qui le tourmentait.
Tout à coup, M. Leuwen quitta son fils.
« Daignez m’attendre », lui dit-il avec amertume.
Il revint bientôt après avec un petit portefeuille de cuir de Russie.
« Il y a là 12 000 francs, et si vous ne les prenez pas, je crois que nous nous brouillerons.⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/402]]==
— Le sujet de la querelle serait neuf, dit Lucien en souriant. Les rôles sont renversés, et…
— Oui, ce n’est pas mal. Voilà du petit esprit. Mais, en un mot comme en mille, il faut que vous preniez une grande passion pour mademoiselle Gosselin. Et n’allez pas lui donner votre argent, et puis vous sauver à cheval dans les bois de Meudon ou au diable, comme c’est votre noble habitude. Il s’agit de passer vos soirées avec elle, de lui donner tous vos moments, il s’agit d’en être fou.
— Fou de mademoiselle Gosselin !
— Le diable t’emporte ! Fou de mademoiselle Gosselin ou d’une autre, que m’importe ! Il faut que le public sache que tu as une maîtresse.
— Et, mon père, la raison de cet ordre si sévère ?
— Tu la sais fort bien. Et voilà que tu deviens de mauvaise foi en parlant avec ton père, et traitant de tes intérêts encore ! Que le diable t’emporte, et qu’après t’avoir emporté il ne te rapporte jamais ! Je suis sûr que si je passe deux mois sans te voir, je ne penserai plus à toi. Que n’es-tu resté à ton Nancy ! Cela t’allait fort bien, tu aurais été le digne héros de deux ou trois bégueules morales. » ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/403]]==⏎
Lucien devint pourpre130.
« Mais dans la position que je t’ai faite, ton fichu air sérieux, et même triste, si admiré en province, où il est l’exagération de la mode, n’est propre qu’à te donner le ridicule abominable de n’être au fond qu’un fichu saint-simonien.
— Mais je ne suis point saint-simonien ! Je crois vous l’avoir prouvé.
— Eh ! sois-le, saint-simonien, sois encore mille fois plus sot, mais ne le parais pas !
— Mon père, je serai plus parlant, plus gai, je passerai deux heures à l’Opéra au lieu d’une.
— Est-ce qu’on change de caractère ? Est-ce que tu seras jamais folâtre et léger ? Or, toute ta vie, si je n’y mets ordre d’ici à quinze jours, ton sérieux passera non pour l’enseigne du bon sens, pour une mauvaise conséquence d’une bonne chose, mais pour tout ce qu’il y a de plus antipathique à la bonne compagnie. Or, quand ici l’on s’est mis à dos la bonne compagnie, il faut accoutumer son amour-propre à recevoir dix coups d’épingle par jour, auquel cas la ressource la plus douce qui reste, c’est de se brûler la cervelle ou, si l’on n’en a pas le courage, d’aller se jeter à la Trappe. Voilà où tu en étais il y a deux mois, moi me tuant de faire comprendre que tu me ruinais en folies de jeune homme. Et en ce bel état, avec ce fichu bon sens sur la figure, tu vas te faire un ennemi du comte de Beausobre, un renard qui ne te pardonnera de la vie, car si tu parviens à faire quelque figure dans le monde et que tu t’avises de parler, tôt ou tard tu peux l’obliger à se couper la gorge avec toi, ce qu’il n’aime pas. Sans t’en douter, malgré tout ton fichu bon sens, que le ciel confonde, tu as à tes trousses huit ou dix hommes d’esprit fort bien disants, fort moraux, fort bien reçus dans le monde, et de plus espions du ministère des Affaires étrangères. Prétendras-tu les tuer en duel ? Et si tu es tué, que devient ta mère, car le diable m’emporte si je pense à toi deux mois après que je ne te verrai plus ! Et pour toi, depuis trois mois je cours les chances de prendre un accès de goutte qui peut fort bien m’emporter. Je passe ma vie à cette Bourse qui est plus humide que jamais depuis qu’on y a mis des poêles. Pour toi, je me refuse le plaisir de jouer ma fortune à quitte ou double, ce qui m’amuserait. Ainsi, tout résolument, veux-tu prendre une grande passion pour mademoiselle Gosselin ?
— Ainsi, vous déclarez la guerre aux pauvres petits quarts d’heure de liberté que je puis encore avoir. Sans reproche, vous m’avez pris tous mes moments, il n’est pas de pauvre diable d’ambitieux qui travaille autant que moi, car je compte pour travail, et le plus pénible, les séances à l’Opéra et dans les salons, où l’on ne me verrait pas une fois en quinze jours si je suivais mon inclination. Ernest a l’ambition du fauteuil académique, ce petit coquin de Desbacs veut devenir conseiller d’État, cela les soutient ; moi, je n’ai aucune passion dans tout cela que le désir de vous prouver ma reconnaissance. Ce qui est le bonheur pour moi, ou du moins ce que je crois tel, c’est de vivre en Europe et en Amérique avec six ou huit mille livres de rente, changeant de ville, ou m’arrêtant un mois ou une année selon que je me trouverais bien. Le charlatanisme, indispensable à Paris, me paraît ridicule, et cependant j’ai de l’humeur quand je le vois réussir. Même riche, il faut ici être comédien et continuellement sur la brèche, ou l’on accroche des ridicules. Or, moi, je ne demande point le bonheur à l’opinion que les autres peuvent avoir de moi ; le mien serait de venir à Paris six semaines tous les ans pour voir ce qu’il y aurait de nouveau en tableaux, drames, inventions, jolies danseuses. Avec cette vie, le monde m’oublierait, je serais ici, à Paris, comme un Russe ou un Anglais. Au lieu de me faire l’amant heureux de mademoiselle Gosselin, ne pourrais-je pas faire un voyage de six mois où vous voudrez, au Kamschatka par exemple, à Canton, dans l’Amérique du sud ?
— En revenant, au bout de six mois, tu trouverais ta réputation complètement perdue, et tes vices odieux seraient établis sur des faits incontestables et parfaitement oubliés. C’est ce qu’il y a de pis pour une réputation, la calomnie est bien heureuse quand on la fuit. Il faut ensuite ramener l’attention du public, et redonner l’inflammation à la blessure pour la guérir. M’entends-tu ?
— Que trop, hélas ! Je vois que vous ne voulez pas de six mois de voyage ou de six mois de prison en échange de mademoiselle Gosselin.
— Ah ! tu parais devenir raisonnable, le ciel en soit loué ! Mais comprends donc que je ne suis pas baroque. Raisonnons ensemble. M. de Beausobre dispose de vingt, de trente, peut-être de quarante espions diplomatiques appartenant à la bonne compagnie, et plusieurs à la très haute société ; il a des espions volontaires, tels que de Perte qui a quarante mille livres de rente. Madame la princesse de Vaudémont était à ses ordres. Ces gens ne manquent pas de tact, la plupart ont servi sous dix ou douze ministres, la personne qu’ils étudient de plus près, avec le plus de soin, c’est leur ministre. Je les ai surpris jadis ayant des conférences entre eux à ce sujet. Même, j’ai été consulté par deux ou trois qui m’ont des obligations d’argent. Quatre ou cinq, M. le comte N…, par exemple, que tu vois chez moi, quand ils peuvent écumer une nouvelle, veulent jouer à la rente, et n’ont pas toujours ce qu’il faut pour couvrir la différence. Je leur rends service, par-ci par-là, pour de petites sommes. Enfin, pour te dire tout, j’ai obtenu l’aveu, il y a quinze jours, que le Beausobre a une colère mue contre toi. Il passe pour n’avoir du cœur que lorsqu’il y a un grand cordon à gagner. Peut-être rougit-il de s’être trouvé faible en ta présence. Le pourquoi de sa haine, je l’ignore, mais il te fait l’honneur de te haïr.
« Mais ce dont je suis sûr, c’est qu’on a organisé la mise en circulation d’une calomnie qui tend à te faire passer pour un saint-simonien retenu à grand-peine dans le monde par ton amitié pour moi. Après moi, tu arboreras le saint-simonisme, ou te feras chef de quelque nouvelle religion.
« Je ne répondrais pas, même si la colère de Beausobre lui dure, que quelqu’un de ses espions ne le servît comme [on] servit Edouard III contre Beckett. Plusieurs de ces messieurs, malgré leur brillant cabriolet, ont souvent le besoin le plus pressant d’une gratification de cinquante louis et seraient trop heureux d’accrocher cette somme au moyen d’un duel. C’est à cause de cette partie de mon discours que j’ai la faiblesse de te parler. Tu me fais faire, coquin, ce qui ne m’est pas arrivé depuis quinze ans : manquer à la parole que je me suis donnée à moi-même. C’est à cause de la gratification de cent louis, gagnée si l’on t’envoie ad patres, que je n’ai pas pu te parler devant ta mère. Si elle te perd, elle meurt, et j’aurais beau faire des folies, rien ne pourrait me consoler de sa perte ; et (ajouta-t-il avec emphase) nous serions une famille effacée du monde.
— Je tremble que vous ne vous moquiez de moi, dit Lucien d’une voix qui semblait s’éteindre à chaque mot. Quand vous me faites une épigramme, elle me semble si bonne que je me la répète pendant huit jours contre moi-même, et le Méphistophélès que j’ai en moi triomphe de la partie agissante. Ne me plaisantez pas ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/404]]==
Trappe. Voilà où tu en étais il y a deux mois, moi me tuant de faire comprendre que tu me ruinais en folies de jeune homme. Et en ce bel état, avec ce fichu bon sens sur la figure, tu vas te faire un ennemi du comte de Beausobre, un renard qui ne te pardonnera de la vie, car si tu parviens à faire quelque figure dans le monde et que tu t’avises de parler, tôt ou tard tu peux l’obliger à se couper la gorge avec toi, ce qu’il n’aime pas. Sans t’en douter, malgré tout ton fichu bon sens, que le ciel confonde, tu as à tes trousses huit ou dix hommes d’esprit fort bien disants, fort moraux, fort bien reçus dans le monde, et de plus espions du ministère des Affaires étrangères. Prétendras-tu les tuer en duel ? Et si tu es tué, que devient ta mère, car le diable m’emporte si je pense à toi deux mois après que je ne te verrai plus ! Et pour toi, depuis trois mois je cours les chances de prendre un accès de goutte qui peut fort bien m’emporter. Je passe ma vie à cette Bourse qui est plus humide que jamais depuis qu’on y a mis des poêles. Pour toi, je me refuse le plaisir de jouer ma fortune à quitte ou double, ce qui m’amuserait. Ainsi, tout résolument, veux-tu prendre une grande passion pour mademoiselle Gosselin ?
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/405]]==
— Ainsi, vous déclarez la guerre aux pauvres petits quarts d’heure de liberté que je puis encore avoir. Sans reproche, vous m’avez pris tous mes moments, il n’est pas de pauvre diable d’ambitieux qui travaille autant que moi, car je compte pour travail, et le plus pénible, les séances à l’Opéra et dans les salons, où l’on ne me verrait pas une fois en quinze jours si je suivais mon inclination. Ernest a l’ambition du fauteuil académique, ce petit coquin de Desbacs veut devenir conseiller d’État, cela les soutient ; moi, je n’ai aucune passion dans tout cela que le désir de vous prouver ma reconnaissance. Ce qui est le bonheur pour moi, ou du moins ce que je crois tel, c’est de vivre en Europe et en Amérique avec six ou huit mille livres de rente, changeant de ville, ou m’arrêtant un mois ou une année selon que je me trouverais bien. Le charlatanisme, indispensable à Paris, me paraît ridicule, et cependant j’ai de l’humeur quand je le vois réussir. Même riche, il faut ici être comédien et continuellement sur la brèche, ou l’on accroche des ridicules. Or, moi, je ne demande point le bonheur à l’opinion que les autres peuvent avoir de moi ; le mien serait de venir à Paris six semaines tous les ans pour voir ce qu’il y aurait de nouveau en tableaux,
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/406]]==
drames, inventions, jolies danseuses. Avec cette vie, le monde m’oublierait, je serais ici, à Paris, comme un Russe ou un Anglais. Au lieu de me faire l’amant heureux de mademoiselle Gosselin, ne pourrais-je pas faire un voyage de six mois où vous voudrez, au Kamschatka par exemple, à Canton, dans l’Amérique du sud ?
— En revenant, au bout de six mois, tu trouverais ta réputation complètement perdue, et tes vices odieux seraient établis sur des faits incontestables et parfaitement oubliés. C’est ce qu’il y a de pis pour une réputation, la calomnie est bien heureuse quand on la fuit. Il faut ensuite ramener l’attention du public, et redonner l’inflammation à la blessure pour la guérir. M’entends-tu ?
— Que trop, hélas ! Je vois que vous ne voulez pas de six mois de voyage ou de six mois de prison en échange de mademoiselle Gosselin.
— Ah ! tu parais devenir raisonnable, le ciel en soit loué ! Mais comprends donc que je ne suis pas baroque. Raisonnons ensemble. M. de Beausobre dispose de vingt, de trente, peut-être de quarante espions diplomatiques appartenant à la bonne compagnie, et plusieurs à la très haute société ; il a des espions volontaires, tels que de Perte qui a quarante mille
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/407]]==
livres de rente. Madame la princesse de Vaudémont était à ses ordres. Ces gens ne manquent pas de tact, la plupart ont servi sous dix ou douze ministres, la personne qu’ils étudient de plus près, avec le plus de soin, c’est leur ministre. Je les ai surpris jadis ayant des conférences entre eux à ce sujet. Même, j’ai été consulté par deux ou trois qui m’ont des obligations d’argent. Quatre ou cinq, M. le comte N…, par exemple, que tu vois chez moi, quand ils peuvent écumer une nouvelle, veulent jouer à la rente, et n’ont pas toujours ce qu’il faut pour couvrir la différence. Je leur rends service, par-ci par-là, pour de petites sommes. Enfin, pour te dire tout, j’ai obtenu l’aveu, il y a quinze jours, que le Beausobre a une colère mue contre toi. Il passe pour n’avoir du cœur que lorsqu’il y a un grand cordon à gagner. Peut-être rougit-il de s’être trouvé faible en ta présence. Le pourquoi de sa haine, je l’ignore, mais il te fait l’honneur de te haïr.
« Mais ce dont je suis sûr, c’est qu’on a organisé la mise en circulation d’une calomnie qui tend à te faire passer pour un saint-simonien retenu à grand-peine dans le monde par ton amitié pour moi. Après moi, tu arboreras le saint-simonisme, ou te feras chef de quelque nouvelle religion.
« Je ne répondrais pas, même
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/408]]==
si la colère de Beausobre lui dure, que quelqu’un de ses espions ne le servît comme [on] servit Edouard III contre Beckett. Plusieurs de ces messieurs, malgré leur brillant cabriolet, ont souvent le besoin le plus pressant d’une gratification de cinquante louis et seraient trop heureux d’accrocher cette somme au moyen d’un duel. C’est à cause de cette partie de mon discours que j’ai la faiblesse de te parler. Tu me fais faire, coquin, ce qui ne m’est pas arrivé depuis quinze ans : manquer à la parole que je me suis donnée à moi-même. C’est à cause de la gratification de cent louis, gagnée si l’on t’envoie ad patres, que je n’ai pas pu te parler devant ta mère. Si elle te perd, elle meurt, et j’aurais beau faire des folies, rien ne pourrait me consoler de sa perte ; et (ajouta-t-il avec emphase) nous serions une famille effacée du monde.
— Je tremble que vous ne vous moquiez de moi, dit Lucien d’une voix qui semblait s’éteindre à chaque mot. Quand vous me faites une épigramme, elle me semble si bonne que je me la répète pendant huit jours contre moi-même, et le Méphistophélès que j’ai en moi triomphe de la partie agissante. Ne me plaisantez pas
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/409]]==⏎
sur une chose que vous savez sans doute, mais que je n’ai jamais avouée à âme qui vive.
— Diable ! c’est du neuf, en ce cas. Je ne t’en parlerai jamais.
— Je tiens, ajouta Lucien d’une voix brève et rapide et en regardant le parquet, à être fidèle à une maîtresse que je n’ai jamais eue. Le moral entre pour si peu dans mes relations avec mademoiselle Raimonde, qu’elle ne me donne presque pas de remords ; mais cependant… (vous allez vous moquer de moi) elle m’en donne souvent… quand je la trouve gentille131. Mais quand je ne lui fais pas la cour…, je suis trop sombre, et il me vient des idées de suicide, car rien ne m’amuse… Répondre à votre tendresse est seulement un devoir moins pénible que les autres. Je n’ai trouvé de distraction complète qu’auprès du lit de ce malheureux Kortis…, et encore à quel prix ! Je côtoyais l’infamie… Mais vous vous moquerez de moi, dit Lucien en osant relever les yeux à la dérobée.
— Pas du tout ! Heureux qui a une passion, fût-ce d’être amoureux d’un diamant, comme cet Espagnol dont Tallemant ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/410]]==⏎
des Réaux nous conte l’histoire. La vieillesse n’est autre chose que la privation de folie, l’absence d’illusion et de passion. Je place l’absence des folies bien avant la diminution de la force physique. Je voudrais être amoureux, fût-ce de la plus laide cuisinière de Paris, et qu’elle répondît à ma flamme. Je dirais comme saint Augustin : Credo quia absurdum. Plus ta passion serait absurde, plus je l’envierais.
— De grâce, ne faites jamais d’allusion indirecte, et de moi seul comprise, à ce grain de folie.
— Jamais ! » dit M. Leuwen ; et sa physionomie prit un caractère de solennité que Lucien ne lui avait jamais vu. C’est que M. Leuwen n’était jamais absolument sérieux ; quand il n’avait personne de qui se moquer, il se moquait de soi-même, souvent sans que madame Leuwen même s’en aperçût. Ce changement de physionomie plut à notre héros, et encouragea sa faiblesse.
« Eh bien, reprit-il d’une voix plus assurée, si je fais la cour à mademoiselle Gosselin ou à toute autre demoiselle célèbre, tôt ou tard je serai obligé d’être heureux, et c’est ce qui me fait horreur. Ne vous serait-il pas égal que je prisse une femme honnête ? »
Ici, M. Leuwen éclata de rire.⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/411]]==
« Ne… te… fâche pas, dit-il en étouffant. Je suis fidèle… à notre traité, ce n’est pas de la partie réservée… que je ris… Et où diable… prendrais-tu ta femme honnête ?… Ah ! mon Dieu ! (et il riait aux larmes) et quand enfin un beau jour… ta femme honnête confessera sa sensibilité à ta passion, quand enfin sonnera l’heure du berger…, que feras le berger ?
— Il lui reprochera gravement qu’elle manque à la vertu, dit Lucien d’un grand sang-froid. Cela ne sera-t-il pas bien digne de ce siècle moral ?
— Pour que la plaisanterie fût bonne, il faudrait choisir cette maîtresse dans le faubourg Saint-Germain.
— Mais vous n’êtes pas duc, mais je ne sais pas avoir de l’esprit et de la gaieté en ménageant trois ou quatre préjugés saugrenus dont nous rions même dans nos salons du juste-milieu, si stupides d’ailleurs. »
Tout en parlant, Lucien vint à songer à quoi il s’engageait insensiblement ; il tourna à la tristesse sur-le-champ, et dit malgré lui :
« Quoi ! mon père, une grande passion ! Avec ses assiduités, sa constance, son occupation de tous les moments ?
— Précisément.
— Pater meus, transeat a me calix iste !
— Mais tu vois mes raisons.⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/412]]==
Fais ton arrêt toi-même, et choisis tes supplices
Cinna, V, sc. 1132.
« J’en conviens, la plaisanterie serait meilleure avec une vertu à haute piété et à privilèges, mais tu n’es pas ce qu’il faut, et d’ailleurs le pouvoir, qui est une bonne chose, se retire de ces gens-là et vient chez nous. Eh bien ! parmi nous autres, nouvelle noblesse, gagnée en écrasant ou escamotant la révolution de Juillet…
— Ah ! je vois où vous voulez en venir !
— Eh bien ! dit M. Leuwen, du ton de la plus parfaite bonne foi, où veux-tu trouver mieux ? N’est-ce pas une vertu d’après celles du faubourg Saint-Germain ?
— Comme Dangeau n’était pas un grand seigneur, mais d’après un grand seigneur. Ah ! Elle est trop ridicule à mes yeux ; jamais je ne pourrai m’accoutumer à avoir une grande passion pour madame Grandet. Dieu ! Quel flux de paroles ! Quelles prétentions !
— Chez mademoiselle Gosselin, tu auras des gens désagréables à force de mauvais ton. D’ailleurs, plus elle est différente de ce ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/413]]==⏎
que l’on a aimé, moins il y a d’infidélité. »
M. Leuwen alla se promener à l’autre bout du salon. Il se reprochait cette allusion.
« J’ai manqué au traité, cela est mal, fort mal. Quoi ! même avec mon fils, ne puis-je pas me permettre de penser tout haut ?
« Mon ami, ma dernière phrase ne vaut rien, et je parlerai mieux à l’avenir. Mais voilà trois heures qui sonnent. Si tu fais ce sacrifice, c’est pour moi uniquement. Je ne te dirai point que, comme le prophète, tu vis dans un nuage depuis plusieurs mois, qu’au sortir de la nuée tu seras étonné du nouvel aspect de toutes choses… Tu en croiras toujours plus tes sensations que mes récits. Ainsi, ce que mon amitié ose te demander, c’est le sacrifice de six mois de ta vie ; il n’y aura de très amer que le premier, ensuite tu prendras de certaines habitudes dans ce salon où vont quelques hommes passables, si toutefois tu n’en es pas expulsé par la vertu terrible de madame Grandet, auquel cas nous chercherions une autre vertu. Te sens-tu le courage de signer un engagement de six mois ? »
Lucien se promenait dans le salon et ne répondait pas.
« Si tu dois signer le traité, signons-le ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/414]]==⏎
tout de suite, et tu me donneras une bonne nuit, car (en souriant) depuis quinze jours, à cause de vos beaux yeux je ne dors plus. »
Lucien s’arrêta, le regarda, et se jeta dans ses bras. M. Leuwen père fut très sensible à cette embrassade : il avait soixante-cinq ans !
Lucien lui dit, pendant qu’il était dans ses bras :
« Ce sera le dernier sacrifice que vous me demanderez ?
— Oui, mon ami, je te le promets. Tu fais mon bonheur. Adieu ! »
Leuwen resta debout dans le salon, profondément pensif. L’émotion si vraie d’un homme si insensible, ce mot si touchant : tu fais mon bonheur, retentissaient dans son cœur.
Mais d’un autre côté faire la cour à madame Grandet lui semblait une chose horrible, une hydre de dégoût, d’ennui et de malheur.
« Devoir renoncer, se disait-il, à tout ce qu’il y a de plus beau, de plus touchant, de plus sublime au monde n’était donc pas assez pour mon triste sort ; il faut que je passe ma vie avec quelque chose de bas et de plat, avec une affectation de tous les moments qui représente exactement tout ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/415]]==⏎
ce qu’il y a de plat, de grossier, de haïssable dans le train du monde actuel ! Ah ! ma destinée est intolérable !
« Voyons ce que dit la raison, se dit-il tout à coup. Quand je n’aurais pour mon père aucun des sentiments que je lui dois, en stricte justice je dois lui obéir ; car enfin, le mot d’Ernest s’est trouvé vrai ; je me suis trouvé incapable de gagner quatre-vingt-quinze francs par mois. Si mon père ne me donnait pas ce qu’il faut pour vivre à Paris, ce que je devrais faire pour gagner de quoi vivre ne serait-il pas plus pénible que de faire la cour à madame Grandet ? Non, mille fois non. À quoi bon se tromper soi-même ?
« Dans ce salon, je puis penser, je puis rencontrer des ridicules curieux, des hommes célèbres. Cloué dans le comptoir de quelque négociant d’Amsterdam ou de Londres correspondant de la maison, ma pensée devrait être constamment enchaînée à ce que j’écris, sous peine de commettre des erreurs. J’aimerais bien mieux reprendre ma vie de garnison : la manœuvre le matin, le soir la vie de billard. Avec une pension de cent louis je vivrais fort bien. Mais encore, qui me donnerait ces cent louis ? Ma mère. Mais si elle ne les avait pas, pourrais-je vivre avec ce que produirait la vente de mon mobilier actuel et les quatre-vingt-quinze francs par mois ? »
Lucien prolongea longtemps l’examen qui devait amener la réponse à cette question, afin de ne pas passer à cet autre examen, bien autrement terrible :
« Comment ferai-je dans la journée de demain pour marquer à madame Grandet que je l’adore ? »
Ce mot le jeta peu à peu dans un souvenir profond et tendre de madame de Chasteller. Il y trouva tant de charme, qu’il finit par se dire :
« À demain les affaires. »
Ce demain-là n’était qu’une façon de parler, car quand il éteignit sa bougie les tristes bruits d’une matinée d’hiver remplissaient déjà la rue.
Il eut ce jour-là beaucoup de travail au bureau de la rue de Grenelle et à la Bourse. Jusqu’à deux heures, il examina les articles d’un grand règlement sur les gardes nationales, dont il fallait rendre le service de plus en plus ennuyeux, car règne-t-on avec une garde nationale ? Depuis plusieurs jours, le ministre avait pris l’habitude de renvoyer à l’examen consciencieux de Leuwen les rapports de ses chefs de division, dont l’examen exigeait plutôt du bon sens et de la probité qu’une profonde connaissance des 44 000 lois, arrêtés et circulaires qui régissent le ministère de l’Intérieur. Le ministre avait donné à ces rapports de Lucien le nom de sommaires succincts ; ces sommaires succincts avaient souvent dix ou quinze pages. Lucien était très occupé de ses affaires de télégraphe et, ayant été obligé de laisser en retard plusieurs sommaires succincts, le ministre l’autorisa à prendre deux commis et lui fit le sacrifice de la moitié de son arrière-cabinet. Mais dans cette position indispensable, le commis futur ne serait séparé des plus grandes affaires que par une cloison, à la vérité garnie de matelas en sourdine. La difficulté était de trouver des gens discrets et incapables par honneur de fournir des articles, même anonymes, à cet abhorré National.
Lucien, après avoir inutilement cherché dans les bureaux, se souvint d’un ancien élève de l’École polytechnique, garçon fort silencieux, taciturne, qui avait voulu être fabricant et qui, parce qu’il avait les connaissances supérieures, avait cru avoir les inférieures. Ce commis, nommé Coffe, l’homme le plus taciturne de l’École, coûta quatre-vingts louis au ministère, car Lucien le découvrit à Sainte-Pélagie, dont on ne put le tirer qu’en donnant un acompte aux créanciers ; mais il s’engagea à ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/416]]==
francs par mois ? »
Lucien prolongea longtemps l’examen qui devait amener la réponse à cette question, afin de ne pas passer à cet autre examen, bien autrement terrible :
« Comment ferai-je dans la journée de demain pour marquer à madame Grandet que je l’adore ? »
Ce mot le jeta peu à peu dans un souvenir profond et tendre de madame de Chasteller. Il y trouva tant de charme, qu’il finit par se dire :
« À demain les affaires. »
Ce demain-là n’était qu’une façon de parler, car quand il éteignit sa bougie les tristes bruits d’une matinée d’hiver remplissaient déjà la rue.
Il eut ce jour-là beaucoup de travail au bureau de la rue de Grenelle et à la Bourse. Jusqu’à deux heures, il examina les articles d’un grand règlement sur les gardes nationales, dont il fallait rendre le service de plus en plus ennuyeux, car règne-t-on avec une garde nationale ? Depuis plusieurs jours, le ministre avait pris l’habitude de renvoyer à l’examen consciencieux de Leuwen les rapports de ses chefs de division, dont l’examen exigeait plutôt du bon sens et de la probité qu’une profonde connaissance des
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/417]]==
44 000 lois, arrêtés et circulaires qui régissent le ministère de l’Intérieur. Le ministre avait donné à ces rapports de Lucien le nom de sommaires succincts ; ces sommaires succincts avaient souvent dix ou quinze pages. Lucien était très occupé de ses affaires de télégraphe et, ayant été obligé de laisser en retard plusieurs sommaires succincts, le ministre l’autorisa à prendre deux commis et lui fit le sacrifice de la moitié de son arrière-cabinet. Mais dans cette position indispensable, le commis futur ne serait séparé des plus grandes affaires que par une cloison, à la vérité garnie de matelas en sourdine. La difficulté était de trouver des gens discrets et incapables par honneur de fournir des articles, même anonymes, à cet abhorré National.
Lucien, après avoir inutilement cherché dans les bureaux, se souvint d’un ancien élève de l’École polytechnique, garçon fort silencieux, taciturne, qui avait voulu être fabricant et qui, parce qu’il avait les connaissances supérieures, avait cru avoir les inférieures. Ce commis, nommé Coffe, l’homme le plus taciturne de l’École, coûta quatre-vingts louis au ministère, car Lucien le découvrit à Sainte-Pélagie, dont on ne put le tirer qu’en donnant un acompte aux créanciers ; mais il s’engagea à
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/418]]==⏎
travailler pour dix et, qui plus est, on put parler devant lui en toute sûreté. Ce secours permit à Leuwen de s’absenter quelquefois un quart d’heure du bureau133.
Huit jours après, le comte de Vaize reçut cinq ou six dénonciations anonymes contre M. Coffe ; mais dès sa sortie de Sainte-Pélagie, Lucien l’avait mis, à son insu, sous la surveillance de M. Crapart, le chef de la police du ministère. Il fut prouvé que M. Coffe n’avait aucune relation avec les journaux libéraux ; quant à ses rapports prétendus avec le comité gouvernemental de Henri V, le ministre en rit avec Coffe lui-même.⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/419]]==
« Accrochez-leur quelques louis, cela m’est tout à fait égal », dit-il à ce commis, qui se trouva fort choqué du propos car par hasard c’était un honnête homme.
Le ministre répondit aux exclamations de Coffe :
« Je vois ce que c’est, vous voulez quelque marque de faveur qui fasse cesser les lettres anonymes des surnuméraires jaloux du poste que M. Leuwen vous a donné. Eh bien ! dit-il à ce dernier, faites-lui une autorisation. Que je signerai, pour qu’il puisse faire copier d’urgence dans tous les bureaux les pièces dont il faudra les doubles au secrétariat particulier. »
À ce moment, le ministre fut interrompu par l’annonce d’une dépêche télégraphique d’Espagne. Cette dépêche enleva bien vite Leuwen aux idées d’arrangement intérieur pour le jeter dans un cabriolet roulant rapidement vers le comptoir de son père et de là à la Bourse. Comme à l’ordinaire, il se garda bien d’y entrer, mais attendait des nouvelles de ses agents en lisant les brochures nouvelles chez un libraire voisin.
Tout à coup, il rencontra trois domestiques de son père qui le cherchaient partout pour lui remettre un billet de deux lignes :
« Courez à la Bourse, entrez-y vous-même, arrêtez toute l’opération, ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/420]]==⏎
coupez net. Faites revendre, même à perte, et, cela fait, venez bien vite me trouver. »
Cet ordre l’étonna beaucoup ; il courut l’exécuter. Il y eut assez de peine, et enfin put courir chez son père.
« Eh bien ! as-tu défait cette affaire ?
— Tout à fait. Mais pourquoi la défaire ? Elle me semble admirable.
— C’est de bien loin la plus belle dont nous nous soyons occupés. Il y avait là trois cent mille francs à réaliser.
— Et pourquoi donc s’en retirer ? dit Lucien avec anxiété.
— Ma foi, je ne le sais pas, dit M. Leuwen d’un air sournois. Tu le sauras de ton ministre si tu sais l’interroger. Cours le rassurer : il est fou d’inquiétude. »
L’air de M. Leuwen ne fit qu’augmenter la curiosité de Lucien. Il courut au ministère et trouva M. de Vaize qui l’attendait enfermé à double tour dans sa chambre à coucher qu’il arpentait, tourmenté par une profonde agitation.
« Voilà bien le plus timide des hommes, se dit Lucien.
— Eh bien ! mon ami ? Êtes-vous parvenu à tout couper ?
— Tout absolument, à dix mille francs près que j’avais fait acheter par Rouillon, que je n’ai plus retrouvé.⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/421]]==
— Ah ! cher ami, je sacrifierais le billet de cinq cents francs, je sacrifierais même le billet de mille pour réavoir cette bribe et ne pas paraître avoir fait la moindre affaire sur cette damnée dépêche. Voulez-vous aller retirer ces dix mille francs ? »
L’air du ministre disait : « Partez ! »
« Je ne saurai rien, se dit Lucien, si je n’arrache le fin mot dans ce moment où il est hors de lui. »
« En vérité, je ne saurais où aller, reprit Lucien de l’air d’un homme qui n’a pas envie de remonter en cabriolet. M. Rouillon dîne en ville, je pourrai tout au plus dans deux heures passer chez lui, et ensuite aller explorer les environs de Tortoni. Mais Votre Excellence veut-elle me dire le pourquoi de toute cette peine que je me suis donnée et qui va engloutir toute ma soirée ?
— Je devrais ne vous rien dire, dit Son Excellence en prenant l’air fort inquiet, mais il y a longtemps que je ne doute pas de votre prudence. On se réserve cette affaire ; et encore, ajouta-t-il d’un air de terreur, c’est par miracle que je l’ai su, par un de ces cas fortuits admirables. À propos, il faut que demain vous soyez assez complaisant pour acheter une jolie montre de femme… » ⏎
==[[Page:Stendhal - Lucien Leuwen, II, 1929, éd. Martineau.djvu/422]]==⏎
Le ministre alla à son bureau, où il prit deux mille francs.
« Voici deux mille francs, faites bien les choses, allez jusqu’à trois mille francs au besoin, s’il le faut. Peut-on pour cela avoir quelque chose de présentable ?
— Je le crois.
— Eh bien ! il faudra faire remettre cette jolie montre de femme avec une chaîne d’or, et cela par une main sûre, et avec un volume des romans de Balzac portant un chiffre impair, 3, 1, 5, à madame Lavernaye, rue Sainte-Anne, n° 90. Actuellement que vous savez tout, mon ami, encore un acte de complaisance. Ne laissez pas les choses faites à demi, raccrochez-moi ces dix mille francs, et qu’il ne soit pas dit, ou du moins qu’on ne puisse pas prouver à qui de droit que j’ai fait, moi ou les miens, la moindre affaire sur cette dépêche.
— Votre Excellence ne doit avoir aucune inquiétude à ce sujet, cela vaut fait », dit Lucien en prenant congé avec tout le respect possible.
Il n’eut aucune peine à trouver M. Rouillon, qui dînait tranquillement à son troisième étage avec sa femme et ses enfants. Et moyennant l’assurance de payer la différence à la revente, le soir même, au café Tortoni, ce qui pouvait être un ⏎
=== no match ===⏎
objet de cinquante ou cent francs, toute trace de l’opération fut anéantie, ce dont il prévint le ministre par un mot.
Lucien n’arriva chez son père qu’à la fin du dîner. Il était tout joyeux en venant de la place des Victoires, où logeait M. Rouillon, à la rue de Londres. La corvée du soir, dans le salon de madame Grandet, ne lui semblait plus qu’une chose fort simple. Tant il est vrai que les caractères qui ont leur imagination pour ennemie doivent agir beaucoup avant les choses pénibles, et non y réfléchir.
« Je vais parler ab hoc et ab hac, se disait Lucien, et dire tout ce qui me viendra à la tête, bon, mauvais ou pire. Je suppose que c’est ainsi qu’on est brillant aux yeux de madame Grandet, cette sublime personne. Car il faut être brillant avant que d’être tendre, et l’on méprise le cadeau si l’objet offert n’est pas de grand prix. »
This site is not affiliated with or endorsed in any way by the Wikimedia Foundation or any of its affiliates. In fact, we fucking despise them.
|